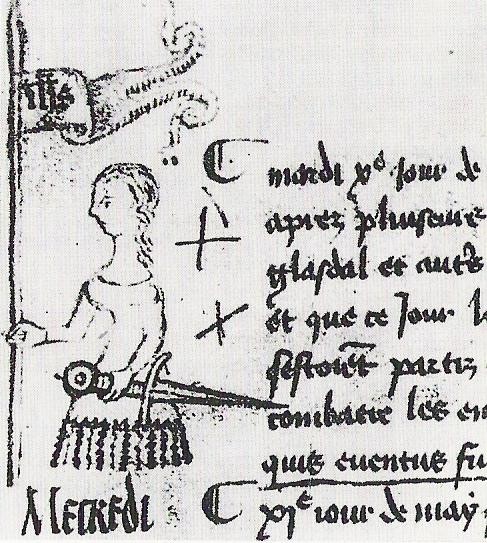A propos de ce blog

Nom du blog :
jehannedarc
Description du blog :
Autour de Jehanne la Pucelle, dite "Jeanne d'Arc".
Articles et travaux divers.
Catégorie :
Blog Société
Date de création :
23.01.2010
Dernière mise à jour :
17.11.2025

>> Toutes les rubriques <<
· Personnages (8)
· Les capitaines Français (11)
· Familles notables d'Orléans (1)
· Les Orléanais (4)
· Domrémy (5)
· Famille de Jehanne la Pucelle - A (8)
· Siège d'Orléans (7)
· Curiosités diverses (1)
· Famille de Jehanne la Pucelle - B (7)
· JEHANNE LA PUCELLE (4)
Accueil
Gérer mon blog
Créer un blog
Livre d'or jehannedarc
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
· Orléans et les Orléanais au temps de Jehanne la Pucelle
· Un exécuteur de la haute justice du roy au moyen-âge.
· QUELQUES FAMILLES NOTABLES D'ORLEANS
· La reine Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI
· Anecdotes Orléanaises de 1431 à 1458.
· Jamet du TILLAY
· Richart GREY, capitaine de Janville en 1428-1429
· ANECDOTE AMUSANTE SUR LES FEMMES VEUVES ET AUTRES PERSONNES
· Le village de Domrémy, en Lorraine
· La famille de Jehanne la Pucelle
· La vie à Domrémy au 15ème siècle
· Guillaume de RICARVILLE
· Ambroise de LORE
· Gilles de LAVAL, baron de RAIS
· Une journée au siège d'Orléans
· geneapope
· blogselestat
· emigrationalgerie
Statistiques 168 articles
animaux annonce argent article belle bonne cadre cheval chevaux chez coeur création
Derniers commentairesprobablement quelqu'un de sa suite...
http://jehanne darc.centerblo g.net
Par jehannedarc, le 19.02.2018
pour laurie thinot. pardon pour le retard... à vous répondre. je n'ai pas connaissance à l'heure actuelle de c
Par jehannedarc, le 07.03.2017
très intéressant! nous y faisons même quelques découvertes!
merci de nous contacter sur le site des "secrets
Par webmestre, le 07.02.2016
bonsoir,
votre liste est impressionnant e ! je vous félicite !
auriez-vous connaissance d'un guillaume de
Par Thinot Laurie, le 23.06.2015
sait-on qui est thomas mitard à qui s'adresse la reine isabeau ?
Par Anonyme, le 04.11.2014

Famille de Jehanne la Pucelle - A
La famille de Jehanne la Pucelle
LA FAMILLE DE JEHANNE LA PUCELLE
Dons, cadeaux et largesses dont a bénéficié la famille de Jehanne,
de la part du roi, du duc d'Orléans et de la ville d'Orléans
--- o ---
Fiefs, propriétés, rentes et tenures diverses
dans l'Orléanais, au travers d'actes notariés
--- o ---
Eléments généalogiques et divers
----------------
Introduction et avertissement
Que Jehanne, que l'on surnommait La Pucelle, ait été le fruit d'un adultère entre Isabeau de Bavière, reine de France, avec son beau-frère, le duc Louis d'Orléans, frère du roi, c'est somme toute possible !
Qu'elle ait été, de ce fait, la demi-soeur à la fois de Charles VII, du duc Charles d'Orléans et de Dunois n'enlève rien à son épopée.
Qu'elle n'ait pas été la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle de Vouthon, dite "Romée", elle a tout de même été élevée et éduquée par eux à Domrémy.
C'étaient donc quand même ses parents, Jacques, Pierre et Jehan ses frères, et Catherine sa soeur.
De cette famille, on parle peu dans les manuels scolaires, les essais historiques ou les publications diverses : pratiquement rien sur Jacques, le père, quelques anecdotes sur Isabeau (ou Isabelle), la mère, sur son séjour à Orléans et son passage à Paris, à Notre-Dame, pour le Procès de Réhabilitation.
Rien sur sa soeur, morte jeune semble-t-il, et très peu sur Jacques fils (ou Jacquemin), le fils aîné, resté au pays, et juste menton que Pierre et Jehan ont quelque peu suivi Jehanne lors de ses pérégrinations.
Qu'était donc cette famille ?
Cette question m'a donné l'envie d'en savoir plus, de "creuser" le sujet, d'exhumer un peu la mémoire de ces gens qui ont vécu avec elle, mangé ou rit avec elle, et participé de près ou de loin à son fabuleux destin.
Bien évidemment, ce ne sont pas des recherches d'historien "officiel", des investigations en règle, des déductions "autorisées", des affirmations officielles... mais seulement le travail sincère d'un passionné de l'Histoire, d'un "fan" de cette jeune fille qui a marqué son siècle, et qu'il m'aurait bien plû de cotoyer et de connaître.
Je n'ai pas "pignon sur rue" pour obtenir des avis "qui comptent", je ne suis ni historien de profession ni professeur de faculté, mais que l'on m'accorde au moins le mérite de chercher des précisions et quelques réponses concernant ce personnage fascinant.
N'étant pas non plus un écrivain "reconnu", le style ne sera peut-être pas toujours idoine, mais j'espère simplament qu'une bonne compréhension, qu'une clarté suffisante se révèleront au travers de ce qui suit.
Les personnages seront suivis au mieux au travers des comptes de la ville d'Orléans, des documents divers et surtout, en ce qui concerne Pierre d'Arc/duLys et sa descencance, grâce à une série de documents officiels, des actes notariés, preuves de leurs activités, principalement dans la région d'Orléans.
On évaluera, tant que faire se peut, leur situation financière, ou - du moins - on en fera une approche.
On tentera de s'approcher de leur personnalité et de leur vie quotidienne.
Des éléments généalogiques et des tableaux nous feront connaître descendants et collatéraux.
Mon souhait est de vous embarquer avec moi sur ce navire à remonter le temps de la recherche historique et de la connaissance, pour appréhender ces gens, cette époque, ces coutumes, qui sont les bases de notre civilisation, et de se rapprocher de cette jeune fille qu'on nommait Jehanne la Pucelle, au travers de cette famille.
Nous rencontrerons aussi des Orléanais, vos ancêtres, les miens, peut-être, qui passeront ainsi à une petite postérité.
Si vous y manifestez quelques atomes d'intérêt, j'en serai comblé.
L'auteur.
---------- o ----------
Petite mise au point rapide sur le Moyen-Age
Quelques mots sur ces serfs, ces paysans et ces seigneurs que l'on va rencontrer au fil des pages, pour connaître un peu plus leurs statuts.
Passages tirés de l'intéressant livre de Jean Sévilla (1) :
"... des pouvoirs locaux s'affirment. Maintenant une cohésion politique minimale, ils exercent l'autorité, battent monnaie, rendent la justice."
Chefs de bande ou maîtres de domaines, des hommes expérimentés s'imposent sur un territoire donné. Sur leurs fiefs (mot tiré du germanique ou du celtique "feodum" qui désigne le droit d'usage d'une terre), ces anciens (en latin "seniores") deviennent des "seigneurs".
"... le système féodal n'a rien à voir avec l'exploitation du sol. D'ailleurs toutes les terres ne sont pas des fiefs. Dans le cas du domaine rural appelé seigneurie, le seigneur ne désigne pas celui à qui le vassal est lié mais le maître du domaine. Le langage contemporain tend à classer dans la même catégorie vassaux, paysans et serfs. Or les nobles sont eux-mêmes des vassaux. Et si beaucoup de paysans sont des serfs, d'autres locataires de leurs terres, sont tenanciers libres, et d'autres encore propriétaires. Hors du domaine royal, patrimoine du monarque, la terre, au Moyen-Age, peut donc être possédée par des nobles, par des communautés monastiques, par des citadins (habitants les villes et les bourgs ils sont, au sens propre, des bourgeois) ou par des paysans".
"... On voit des laboureurs plus fortunés que les petits nobles ruinés par la guerre".
"... Les corvées, auxquelles les manuels de jadis faisaient une réputation effrayante, se bornent à 1 ou 2 jours de travail par an, 6 au maximum. Ces services, dûs au seigneur par les tenanciers et dépendants, libres et non libres, consistent à entretenir les ponts et les routes, ou à curer les fossés, tâches relevant aujourd'hui des communes".
"... Un serf n'est certes pas un homme libre. Il n'est pas non plus un esclave. Le droit romain reconnaissant le droit de vie ou de mort sur l'esclave : rien de tel n'existe au Moyen-Age".
"... Si le serf est tenu de rester sur le domaine et de le cultiver, s'il peut être vendu avec les terres, il ne peut en être explusé et reçoit sa part de moisson. Il est libre de se marier (contrairement à l'esclave antique) et de transmettre sa terre et ses biens à ses enfants".
(1) "Historiquement correct - Pour en finir avec le passé unique", J. Sévilla, Perrin, 2003, p.26,28 et 29.
------ o ------
A Domrémy - Situation des d'Arc - Finances de Jehanne
En 1404, Jacques d'Arc est cité comme "laboureur" à Domrémy.
Il était né entre 1375 et 1380 à Ceffonds, près de Montier-en-Der, où son père s'était installé pour participer au défrichement du terrain afin de construire une abbaye.
Là, on lui donna comme patronyme, le nom du lieu d'où il venait : Arc-en-Barrois, au nord-ouest de Langres.
Vers 1400, Jacques était arrivé dans la chatellenie de Vaucouleurs, aux confins du Barrois, seul fief de la région rattaché à la couronne de France.
Il s'installe à Domrémy, hameau de 40 à 50 feux, et épouse Isabelle (ou Isabeau, dite "Zabillet"), originaire de Vouthon, village situé à moins de deux lieues.
Le couple va vivre dans une maison, tout près de l'église, que l'on pense avoir été apportée en dot par Isabelle.
Elle est modeste, mais bâtie "en dur", chose qui n'était pas monnaie courante en ces temps-là. Elle est assez longue, basse, massive et obscure. Une ou deux fenêtres en façade. Le sol nu est de terre battue. Les meubles sont rudimentaires : grande table rustique, escabeaux, la maie, les coffres et la huche.
Dans l'âtre, les landiers en fer battu, la crémaillière.
Aux parois, de grossières chevilles, des râteliers pour les paniers, deux ou trois chandeliers de bois.
Les murs sont noircis par la fumée et la suie. Un crucifix, couronné par le buis béni des Rameaux.
Devant la porte, une aire poussiéreuse l'été, fangeuse en toute autre saison, souillée du purin qui stagne.
Des poules qui picorent. A côté, des dépendances pour les animaux domestiques. Derrière la maison, jouxtant l'église, le courtil touche au cimetière.
Mais il s'agit de la maison d'un notable, bien que la famille ne soit pas bien riche.
Ils vivent du produit d'un "gagnage", terre affermée ou possédée (on ne sait pas) qu'ils cultivent pour le lin, le colza, le froment et les légumes, sans grande variété, de ce temps.
Quelques têtes de bétail. On bat le chanvre, file la laine et l'étoupe; on pétrit son pain qu'on porte cuire au four banal. Les repas sont frugaux.
L'habillement est simple et propre, mais constamment rapetassé.
Mais Jacques est issu d'une famille d'ancienne chevalerie, dont certaines belles alliances avaient parfois atteint l'entourage des grandes familles. Ils n'étaient pas de haute noblesse, mais nobles tout de même, et, comme beaucoup d'entre-eux au XIVème siècle, la branche de Jacques avait été ruinée par les conséquences économiques de la Guerre-de-Cent-Ans, et de la Peste Noire de 1348.
Mais il fallait vivre, et beaucoup durent travailler de leurs mains. Dans ce cas, ils tombaient en "dérogeance", perdant la qualité et aussi les prérogatives de la noblesse.
Si la "déchéance", elle, était infâmante et définitive, la dérogeance pouvait être abrogée par décision royale. C'est d'ailleurs ce que leur octroye Charles VII dans l'acte d'anoblissement de décembre 1429 : il leur a rendu leur qualité de nobles. Avec juste une différence (rare toutefois) : la noblesse pouvait être transmise par les femmes à leurs maris.
Grâce à la vente de petits fiefs, Jacques loue des terres cultivables.
De son côté son épouse, Isabelle de Vouthon, dite "Romée" probablement à cause d'un pèlerinage qu'elle avait effectué au Puy-en-Velay, est sans fortune pour des raisons identiques.
C'est une femme de grande valeur, appartenant au Tiers-Ordre Franciscain, et qui sera plus tard l'amie intime de Sainte-Colette-de-Corbie, supérieure des Clarisses, le pendant féminin des Franciscains. Les deux familles ont des origines et des alliances équivalentes : elles sont "du même milieu" dirait-on aujourd'hui.
A la suite de son installation à Domrémy, Jacques accepte des honneurs et des responsabilités. Il est à la fois le doyen, chef des archers, pour devenir en 1419 "fermier-général" des lieux, charge déjà importante. Il sera investi de diverses fonctions : collecte des tailles, charge de la police, et aussi délégation comme procureur-fondé à l'occasion de plusieurs procès importants concernant Domrémy, devant Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs (nb : celui-ci savait donc qui était Jehanne !).
En 1419, Jehanne de Joinville, nièce du sire de Bourlemont, avait hérité de son oncle une petite forteresse qu'on nommait "le château de l'Ile", située sur un ilôt de la Meuse. Le château ne trouvant pas d'acheteur (la jeune héritière avait épousé et suivi à Nancy le seigneur Henri d'Ogévillier), elle le loua aux plus offrants. Ce furent Jacques d'Arc (Jacquot d'Ars) et l'un de ses voisins, Jehan Biget (ou Bizet) qui l'emportèrent.
Jacques s'occupe du domaine, et dirige la maison-forte, véritable lieu fortifié, où les populations voisines viendront s'abriter souvent lors de raids. Le loyer annuel, payable à la Saint-Jean, était de 14 livres tournois et 3 "imaux" de blé (environ 6 boisseaux). Ils eurent pour neuf ans la jouissance de la bâtisse, du jardin, de la cour et des prairies, la chapelle Notre-Dame, qui s'élevait sur le domaine, faisant seule exception au bail.
Ils traitèrent avec cinq locataires, dont le premier fut Jacquemin d'Arc, le fils aîné, sans doute déjà marié. Le lieu était donc important, et les enfants de Jacques et d'Isabelle, Jehanne y compris, dûrent s'y rendre souvent.
En somme, si le travail manuel a fait perdre à Jacques la qualité de noble, il en possède néanmoins de nombreuses prérogatives.
Où trouve-t-on ici l'humble condition paysanne d'une légende bétifiante ?
Jehanne est donc élevée dans ce milieu, et jamais elle ne fut bergère, même si parfois elle aidait à mettre à la pâture le troupeau commun, et elle y reçut une éducation un peu plus poussée que le commun des filles du lieu, apprenant même à lire et à écrire. Un milieu, non pas riche, mais bénéficiant d'une certaine aisance.
Bien que certains membres aient eu des charges déjà par le passé, la situation grâce à l'épopée de Jehanne, va s'améliorer; charges et honneurs vont se multiplier et, côtoyant l'entourage du roi, la famille va profiter des largesses de Charles VII et du duc d'Orléans.
Jehanne elle-même reçut des cadeaux, des chevaux, des armures, des robes et de l'argent. Elle attesta elle-même que, lors de sa capture, elle possédait des sommes importantes :
"... Elle dit ensuite que ses frères ont ses biens, chevaux, épée, à ce qu'elle croit, et aultres, qui valent plus de 12.000 écus". (Procès de Condamnation).
"... Elle répondit qu'elle avait 10 ou 12.000 écus qu'elle a vaillant; mais ce n'était pas un grand trésor pour conduire la guerre; c'est même peu de choses; ce sont ses frères qui ont cela, à ce qu'elle pense. Et elle dit que ce qu'elle a est du propre argent du roi". (Procès de Condamnation).
Où sont passé ces 12.000 écus ? Une forte partie a été probablement consacrée à la solde des hommes d'armes que Jehanne a enrôlés elle-même, après le Sacre et Paris, en particulier pour l'expédition de La-Charité-sur-Loire, alors que, désavouée par le roi qui voulait alors que la diplomatie prenne le pas sur la guerre, elle devint chef de bande.
Sans doute une autre partie a-t-elle pu être utilisée par Pierre d'Arc, prisonnier avec elle à Compiègne, pour payer la forte rançon qu'on avait exigée, et pour laquelle d'ailleurs il fut contraint de vendre l'héritage de sa femme.
L'un des deux frères aurait-il aussi investi une autre partie de cet argent à Orléans car, dans les titres de l'Hôtel-Dieu de la ville, on trouve une mention bien curieuse en 1450 :
"Don faict à l'Hostel-Dieu d'Orliens, d'une place et cour assize derrière la maison de la Souche, rue de la Porte Bourgoigne, tenante d'un long à la maison de la Pucelle, d'autre long à Guillaume Escot, d'autre bout sur la rue Coquille".
Aurait-on (ou avait-elle) voulu réserver un hâvre, pour revenir vivre plua tard, après la tourmente ? On n'en sait rien. Dans les successions de Pierre, resté dans l'Orléanais, ou de son fils Jehan, on ne parle pas d'une telle maison. Mais le fait reste quand même troublant.
nb : pour l'anecdote, ce Guillaume "Escot" cité plus haut, était peut-être un archer ou un homme d'armes écossais (on disait "Escossois" ou "Escot"), des troupes travaillant pour le roi de France, et qui serait resté sur place après les combats du siège. On disait "un Escot", ce qui a donné : L'Escot, Lescot, Descot, Lescaut, Lescault...
Pour en revenir à ce qu'à reçu Jehanne, on trouve dans les comptes du Trésorier des Guerres de Charles VII, Hémon Raguier, ce qui suit. Elle ne fut pas oubliée dans la distribution des sommes que Charles VII accorda à ceux qui l'avaient suivi fidèlement. Elle est considérée comme les autres capitaines et chefs de guerre.
Cet extrait du 13ème compte d'Hémon Raguier en donne une idée :
"L'estat du voïage faict à Reims pour le sacre et couronnement illec du roi nostre seigneur. Par lettres-patentes du 22 septembre 1429, au château de Gien :
"A Jehanne la Pucelle, 249 livres tournois forte monnoye et 30 ducats d'or,... au faict de la despense ordonnée par elle faire au voïage faict par ledit seigneur à Reims, pour le faict de son sacre et couronnement...
"A Jehanne la Pucelle, 236 livres tournois forte monnoye... C'est à sçavoir pour ung cheval que ledit seigneur luy fist bailler et délivrer à Orliens au dit moys d'aoust, 38 livres 10 solz tournois.
"Pour ung aultre cheval que semblablement le dit seigneur luy fist bailler et délivrer à Senlis au dit mois de septembre, six-vingt dix-sept livres 10 solz tournois.
"Et à Reims, que icelui seigneur luy fist bailler et délivrer pour bailler à son père, 60 livres tournois".
nb : elle possédait aussi 5 "coursiers" et 7 "trottiers".
Et aussi :
"Aux chiefs et capitaines de guerre cy-après nomméz, la somme de deux mil quatre cens neuf escus d'or :
Dont :
"A Jehanne la Pucelle, pour despence, 40 escus".
Puis :
"Aux personnes cy-après nommées, la somme de 450 livres tournois qui, au moys d'avril 1429 après Pasques, de l'ordonnancement et commandement du Roy nostre seigneur, a esté paié et baillée par le dit trésorier. C'est à sçavoir :
"A Jehan de Mes(Metz), pour la despence de la Pucelle, 200 livres tournois.
"Au maistre armeurier pour un harnois complet pour la dite Pucelle. Au dit Jehan de Mes et son compaignon pour luy aidier à avoir des harnois, pour eulx armer et habiller, pour estre en la compaignie de la dite Pucelle : six-vingt cinq livres tournois.
"Et à Hauves Poulvoir, paintre, demourant à Tours, pour avoir paint et baillé étoffes pour un grant estandart et ung petit pour la Pucelle : vingt-cinq livres tournois".
On dépense donc des sommes importantes pour la Pucelle, soit, pour ici :
- 30 ducats d'or et 249 livres pour défraiement et voyage à Reims,
- 236 livres, pour deux chevaux, et 60 livres pour Jacques son père,
- 40 écus d'or, pour ses dépenses personnelles.
- 200 livres, pour sa "Maison" (son escorte),
- 125 livres pour des harnois (équipements),
- 25 livres pour la confection de deux étendards,
soit au total 30 ducats d'or et 835 livres tournois (sur environ deux mois). Jehanne est payée comme les autres seigneurs et capitaines.
Après 1431 et la tourmente de l'épopée, la famille se retrouve un temps à Domrémy.
Jacques fils, l'âiné, qui n'avait pas participé aux combats, avait sans doute déjà repris la succession de son père. On ne sait pas ce que devint Pierre, avant son établissement à Orléans avec sa mère, veuve, en juillet 1440. Il percevra durant un temps le péage de Chaumont. (D'ailleurs, quand avait-il été fait chevalier ? On n'en parle nulle part. Etait-ce à Reims, au sacre ?)
Jehan, dit "Petit-Jehan" poursuivra une carrière militaire. Il fut capitaine de Chartres et bailli de Vermandois, avant de terminer avec la charge de prévôt de Vaucouleurs. Toutefois sa fille, Marguerite, restera dans l'Orléanais et y épousera - nous le verrons plus loin - un seigneur local.
Isabelle "Romée" dut voir Jehanne pour la dernière fois au moment du sacre à Reims en juillet 1429. On sait qu'elle fit le déplacement avec son époux, et qu'ils séjournèrent un mois sur place, habitant à l'Auberge de l'Ane Rayé. Jehanne était intervenue pour que le roi accorde des exonérations pour Domrémy, et fit remettre à ses parents, on l'a vu, 60 livres tournois.
Il semble toutefois que leur situation financière ne soit pas vraiment florissante, dans leur pays, malgré ce que nous verrons plus loin, ce qui motivera sans doute l'émigration de certains membres à Orléans et dans la région. Jehanne n'était plus défrayée par le roi :
Pour en terminer avec Jehanne et relativiser les dons, voici ce que nous dit Mr. Olivier Bouzy (1) au sujet de l'une de ses armures :
"A Tours, Charles VII paya à Jehanne une armure coûtant 100 écus. L'écu de 1429 ayant un cours de 25 sols, l'armure de Jehanne coûta donc 2.500 sols, soit 125 livres tournois, la livre valant 20 sols...
La valeur de la monnaie de Charles VII varie beaucoup dans les années 1417 à 1430...
Que valait réellement l'armure de Jehanne... Les points de comparaison sont rares.
On peut observer que des armures complètes se sont vendues à Lille, en 1434, pour des dommes allant de 18 à 246 livres...
Compte tenu du fait que, en 1429, la monnaie du roi vaut à peu près le tiers de Philippe-le-Bon (pied 96c contre 30c en avril, le pied indiquant le nombre de deniers taillés dans un marc d'argent), on doit convertir ces sommes : l'équivalent en monnaie royale française aurait été de 57 à 787 livres.
L'armure de Jehanne n'est donc pas tout à fait le bas de gamme, on sait d'ailleurs par le témoignage du comte de Laval qu'il s'agissait d'un "harnois blanc" (NB : blanc comme le métal utilisé, l'acier), c'est-à-dire de pièces d'armures d'un seul tenant, et non d'une brigandine.
L'armure valait seulement deux fois plus que l'équipement le moins coûteux, et presque huit fois moins que le plus cher.
Pour ce prix, il est donc hors de question que l'armure ait été faite sur mesure, il ne peut s'agir que de pièces fabriquées à l'avance, peut-être adaptées à la taille de Jehanne : une sorte de prêt-à-porter."
Cette armure n'était donc pas un somptueux cadeau, mais un "instrument de travail" de qualité suffisante pour son usage.
Jehanne recevra d'autres cadeaux, telle une princesse, en particulier une robe, à Orléans, dont le tissu avait été payé très cher.
(1) "Jehanne d'Arc, mythes et réalités", O. Bouzy, Orléans, 1999.
------ o ------
Pour évaluer un peu les revenus de la famille d'Arc
Personnages principaux que nous rencontrerons :
- Isabelle de Vouthon, dite "Romée" : épouse de Jacques d'Arc, soeur de Mengin.
- Mengin de Vouthon : frère d'Isabelle, oncle de Jehanne.
- Jacques d'Arc père : époux d'Isabelle, père de Pierre d'Arc/du Lys.
- Pierre d'Arc, puis du Lys : fils de Jacques et Isabelle.
- Jehan du Lys : fils de Pierre d'Arc/du Lys.
- Marguerite du Lys : fille de Jehan d'Arc/du Lys, nièce de Pierre d'Arc/du Lys.
- Antoine de Brunet : époux de Marguerite du Lys.
- Jehan de Brunet : fils d'Antoine de Brunet et de Marguerite.
Ce sont ces personnages que l'on retrouvera dans les actes étudiés plus loin.
Ils sont tous "de la famille", établis en Orléanais.
Nous n'avons pas d'élements d'appréciation pour Jacques fils (Jacquemin) et Jehan, l'autre frère (fils de Jacques et d'Isabelle), capitaine de Chartres.
On verra ci-après une liste des propriétés, rentes, bails, fiefs et bien divers de ceux établis dans la région Orléanaise.
Puis une évaluation succincte des revenus et charges.
Les comptes de la ville d'Orléans nous apporterons d'autres éléments.
Mais tout cela n'atteignait pas des sommes vraiment importantes.
On détaillera enfin vingt actes notariés concernant ces personnes.
Voici une liste, non exhaustive, des biens familiaux :
- Le château de l'Ile, à Domrémy (Jacques père).
- Péage de Chaumont (Pierre du Lys).
- Villiers-Charbonneau à Ardon (Jehan du Lys, Antoine et Jehan de Brunet).
- Métairie de Bagneaux à Sandillon (Pierre du Lys et son fils Jehan, Antoine et Jehan de Brunet).
- L'ile-aux-Boeufs à Combleux (Pierre et Jehan du Lys, Antoine de Brunet).
- Maison à Orléans, près de l'église de Saint-Pierre-le-Puellier (Pierre et Jehan du Lys).
- Rente de 125 livres du roi (Pierre et Jehan du Lys).
- Rente de la ville d'Orléans (Isabelle "Romée").
- Luminart à Saint-Denis-en-Val (Mengin de Vouthon et son épouse).
- Rentes acquises au mariage (Jehan du Lys).
- Etang du Coigner à La-Ferté (-Saint-Aubin) (Jehan du Lys).
- La Couaspellière à Menestreau-en-Villette (Jehan du Lys).
- Des vignes à Savigny, près Sandillon (Jehan du Lys).
- Rentes sur le lieu de La Goislière (Jehan du Lys).
- Le Mont, à Saint-Denis-en-Val (Antoine de Brunet).
- Métairie de Lussault à Viglain (Antoine et Jehan de Brunet).
- Maison au bourg de Sandillon (Antoine et Jehan de Brunet).
- Vignes à Puchesse (Sandillon) (Antoine et Jehan de Brunet).
Revenus, charges, évaluation succinctes concernant ces objets :
Tout cela est bien difficile à évaluer ! Il faudrait des éléments plus précis, d'autres documents, et un avis de spécialiste pour faire une évaluation correcte.
Les actes étudiés plus loin nous en détaillerons un peu plus. Mais, très succinctement :
- Château de l'Ill, à Domrémy : loyer de 14 livres tournois/an. Revenus ?
- Péage de Chaumont : bénéfices ?
- Villiers-Charbonneau : 1°) 3 métairies qui doivent 2 mines de blé, un pain, une gésine et un denier. 2°) 2 sols parisis par arpent, soit 12 sols parisis et deux poules.
- Métairie de Bagneaux : Cultures - Petit élevage.
- L'Ile-aux-Boeufs : Pas de redevance ducale. Usufruit. 115 sous parisis pour forestage, 10 écus d'or pour pâturages. Quelques cultures, élevage, fruits et divers.
- Maison d'Orléans : bail à rente de 32 sols parisis pour St. Euverte.
- Rente de 125 livres du roi : à Pierre puis à son fils Jehan du Lys.
- Rente de la ville d'Orléans : 48 sous parisis (ou 60 sous tournois), exclusivement pour Isabelle et qui cesse à son décès.
- Luminart : chargé de 28 sols 3 deniers de cens/an. Vendu par Mengin de Vouthon pour 10 livres tournois. Cultures, bois.
- Rente au mariage : Jehan du lys : rente de 10 livres parisis.
- Etang du Coignier : au moins un revenu de 13 livres 16 sols : poisson.
- La Couaspellière : ?
- Vignes à Savigny : ?
- Rente sur La Goislière : ?
- Le Mont : ?
- Lussault : ?
- Maison à Sandillon : ?
- Vignes à Puchesse : ?
A titre de comparaison, pour nous donner une idée, voici le prix de diverses denrées à cette époque :
- La mine de blé froment : 2 sous 4 deniers.
- La pinte de vin rouge : 6 deniers.
- Une vache : 44 sous.
- Un mouton : 10 sous.
- Un agneau : 3 sous.
- Un porc : 26 sous.
- Un cent d'oeufs : 3 sous.
- Une paire de pigeons : 8 deniers.
- Un cent de harengs : 6 sous.
- Une livre de beurre salé : 7 deniers.
- Une livre de beurre frais : 8 deniers.
- Une livre de beurre de safran : 3 livres 8 sous.
- La livre de cire : 3 sous.
- Un veau : 18 sous.
- Une douzaine de poulets : 8 sous.
- Une livre de sucre : 5 sous.
- Une livre de poivre : 4 sous 4 deniers.
- Un muid de sel (mesure de Paris) : 2 livres.
- La pinte de vin ordinaire clairet : 4 deniers.
Mesures :
. 1 muid = 12 mines; une mine = 50 livres.
- 1 tonneau = 2 traversins; un traversin = 210 pintes, soit 240 litres (soit environ 1,14 litres la pinte).
Voir la suite à l'article : Dans les comptes de la ville d'Orléans.
------ o ------
Dans les comptes de la ville d'Orléans.
Dans les comptes de la ville d'Orléans
Le 29 avril 1429, vers 20 heures, Jehanne la Pucelle entre dans Orléans par la Porte Bourgogne, accompagnée d'hommes d'armes, de munitions et de provisions dont une partie avait transité jusqu'à la ville par la Loire.
Deux de ses "frères", Pierre et Jehan, étaient du nombre. On ne sait pas exactement s'ils furent un temps logés avec Jehanne chez Jacques Boucher, le trésorier du duc d'Orléans, dans la maison de l'Annonciade.
On ne cite ni l'un ni l'autre dans les chroniques et les récits qui parlent de la prise des Tourelles et de la délivrance de la cité, parmi ceux qui se distinguèrent lors de ces évènements, bien qu'ils aient été sur place.
Les comptes de la ville les citent un peu plus tard :
Samedi 11 juin 1429 : Jehanne quitte Orléans avec l'armée pour se porter sur la ville de Jargeau qui sera bientôt délivrée. Parmi ces troupes, on comptait aussi certains orléanais qui la suivirent dans cette expédtion composée, dit-on, de 8.000 combattants. Pierre et Jehan y participent.
Ce jour-là, avant le départ, et par ordonnance des Procureurs de la ville, Charlot-le-Long fournit "aux frères de La Pucelle trois paires de houseaux" (guêtres en cuir qui s'attachaient avec une broche en fer en place de boutonnière), et aussi "trois paires de souliers". Les procureurs chargent aussi l'un d'eux, Jehan Morchoasme, de payer à Thévenon Vildart "la despence que ont faict en son ostel les frères de La Pucelle" pendant leur séjour à Orléans. Ils ont donc résidé un temps chez ce Villedart.
De plus, les deux frères ne repartirent pas les mains vides, car le même Procureur fut chargé de "bailler auxdicts frères de La Pucelle, pour don à eulx faict, trois escus d'or qui ont cousté chascun 60 sous parisis". (Cela représente environ le prix d'une vache et de deux moutons).
Etaient-ils à la bataille de Patay ? On sait qu'ils assistèrent au sacre, et que Pierre, prisonnier à Compiègne en même temps que Jehanne, dut payer une rançon. Plus tard, en Juillet 1440, Pierre et sa mère Isabelle s'installent à Orléans.
Jehan y séjourna aussi, probablement, mais poursuivit la carrière des armes. Il fut capitaine de Chartres, bailli de Vermandois (1454) puis prévôt de Vaucouleurs (de 1455 à 1468), repartant ainsi dans son pays. Sa fille unique, Marguerite du Lys, se mariera avec un seigneur tenant un fief à Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans, et restera donc sur place, près du lieu des exploits de sa tante.
Jacques, le frère aîné, avait rejoint Jehanne à Blois, mais s'en retourna très vite en Lorraine; il ne participe pas à l'épopée, reprenant sans doute la succession de son père à Domrémy.
Cette famille a été l'objet de largesses, non seulement de la part de la ville d'Orléans, mais aussi de celle du roi, et surtout du duc d'Orléans.
En ce qui concerne Jehanne, on en trouve trace dans les comptes de la ville d'Orléans, au jour du 8 mai 1429 :
Ce jour-là, un dimanche, une procession générale est faite, partant de la cathédrale Sainte-Croix jusque'à Notre-Dame-des-Miracles, dans le quartier Saint-Paul, tous près de la résidence de Jacques Boucher.
Y assistaient la majeure partie des Orléanais, le clergé, les religieux de tous ordres, les magistrats, les corps constitués, les militaires, et surtout La Pucelle, portant son étendard victorieux, le plus bel ornement de cette première fête, préfiguration de celles qui vont suivre et se perpétrer jusqu'à nos jours.
Jehanne ne fut pas oubliée, et les Orléanais, par l'entremise des Procureurs, lui font plusieurs présents. Jehan Hilaire, receveur des deniers publics, paye entre autres ce jour-là :
"A Jacquet Compaing, pour demi aulnes de vers (étoffe) achestés pour faire les orties (ornements ou broderies représentant des orties, emblème de la famille d'Orléans) des robes de La Pucelle, le jour du lièvement du siège d'Orliens : 6 sous parisis".
(nb : Jehanne faisait-elle donc partie de cette famille pour qu'elle soit autorisée à en porter les signes ?!)
"A Massot Bariant, pour avoir tiré à clert un tonneau de vin prins (pris) chez Jehan Morchoasme, pour donner à Jehanne, le jour du lièvemens du siège d'Orliens : 6 sous parisis".
(C'était la coutume alors de faire ce type de cadeau aux gens qu'on voulait honorer; et puis, Jehanne dût bien un peu faire "la fête" avec ses proches pour cette occasion !)
"A Jehan Lebrun, sellier, pour l'achat d'un bast à bahu (selle arrondie sur le dessus) et pour ung bahu (coffre dont le couvercle est arrondi et couvert de clous de cuivre), serrures, courroys, sangles et pour touailles (toiles, tissus) pour le guernir (le garnir) par dedens avec couverture, pour donner à Jehanne La Pucelle, pour le tout : 76 sous parisis".
"A Jehan Morchoasme, pour argent baillé pour l'achat de 6 chapons, 9 perdrix, 12 congnins (des lapins, lièvres) et ung fésan, présentés à Jehanne La Pucelle : 6 livres 12 sols 3 deniers parisis".
(Jehanne et son entourage ont dû faire bombance ce jour-là ! Cela la changea certainement de ses morceaux de pain trempés dans un peu de vin coupé d'eau, collation frugale dont elle était coutumière(.
En janvier 1430, Jehanne, qui devait séjourner au château de Sully, chez le seigneur de Trémoille, invitée à Orléans pour un banquet, fit le voyage à Orléans. La ville paya :
"Le 19ème jour de janvier, il est dû à Jehan Morchoasme, pour argent baillé pour l'achat de 6 chapons, 9 perdrix, 13 congnins et ung fésan, présentez à Jehanne La Pucelle, maistre Jehan de Velly et monsieur de Mortemar : 6 livres 12 sous 4 deniers parisis".
"Et à Jacquet Leprestre pour trois pintes de vin présentées aux dessusdits à deux repas, ledit jour : 3 sous parisis".
(nb : le seigneur de Mortemar était le châtelain de Montpipeau, forteresse située à Huisseau-sur-Mauves, près de Meung-sur-Loire, dont une partie du château médiéval, en bon état, subsiste encore de nos jours. La forteresse fut occupée durant environ 7 mois par les Anglais, sous le commandement du capitaine anglais Richart Waller.)
Toujours dans les comptes de la ville, plus tard : il s'agit de la "réapparition" de Jehanne, sous le nom de "la Dame des Armoises", qui annonce qu'elle se rendra à Orléans. Tout Orléans la reconnaîtra pour telle.
- 09/08/1436 : "A Fleur-de-Lys, hérault de ladicte ville, le jeudy de Sainct Lorens, pour don à luy faict pour ce qu'il avoit apporté lectres à la ville de par Jehanne La Pucelle : 2 réaulx, à 24 sous parisis, soit 49 sous parisis".
- 21/08/1436 : "A Jehan Dulis, frère de La Pucelle, le mardy XXI d'aoust MXXXXXXXVI, pour 12 poulets, 12 pigeons, 2 oisons et 2 levrots : 38 sous parisis".
(Le frère de Jehanne, lui-même, vient annoncer à la ville d'Orléans que sa soeur est vivante, et qu'elle souhaite revenir à Orléans. Pourquoi se serait-il rendu complice d'une supercherie ?).
- Même date : "Pour don à luy faict la somme de 12 livres tournois pource que ledict frère de La Pucelle vint en la Chambre de ladicte ville, réquérir aux Procureurs de la ville qu'ilz luy voulissent aidier d'aulcung poy (d'un peu) d'argent pour s'en retourner par devers sa dicte soeur, disant qu'il venoit de devers le roy luy annoncer que sa soeur Jehanne existoit et que le roy luy avoit ordonné (promis) 30 francs et commandé que on les bailla, ce dont on ne fist rien, et ne luy en fust baillé que 20 dont il avoit despendu (dépensé) les 12 et ne luy en restoit plus que 8 francs, qui estoit poy de choses pour s'en retourner à Metz, devers sa soeur Jehanne, veu (vu) qu'il estoit cinquiesme à cheval (*)... On luy donna 12 francs, valent : 9 livres 12 sous parisis".
* Cela voulait probablement dire qu'il était accompagné de quatre personnes, et qu'ils étaient donc cinq pour repartir.
La ville d'Orléans dépêche un messager, pour vérifier la véracité de la nouvelle, et probablement aussi pour vérifier son sceau :
- 18/10/1436 : "A Cueur-de-Lys, hérault de ladicte ville, le 18ème jour d'octobre MCCCCXXXVI, pour ung veïage qu'il a faict pour ladicte ville, par devers La Pucelle, laquelle estoit à Arlon, en la duchié de Luxembourg, et pour porter les lectres qu'il apporta de ladicte Jehanne La Pucelle, à Loiches (Loches) par devers le Roy, qui là estoit, au quel veïage il a vacqué 41 jours; c'est assavoir :
. 34 jours au veïage de La Pucelle,
. 7 jours pour aller devers le Roy et par ledit Cueur-de-Lys, pour aller vers ladicte Pucelle, le mardy, dernier jour de juillet, et retourna le 2ème jour de septembre ensuivant, ainsi sont 41 jours qu'il a demouré à vacqué à faire le dict veïage, pour tout : 6 livres parisis".
"Le dict 2ème jour de septembre, pour pain, vin et cernaulx despensés en la Chambre de ladicte ville à la venue dudict Cueur-de-Lis qui apporta lesdictes lectres de Jehanne La Pucelle, et pour faire boire ledict Cueur-de-Lis lequel disoit avoir grant soif, pour ce : 2 sous 4 deniers parisis".
(Le nommé Coeur-de-Lys venait faire son rapport aux dirigeants de la ville, certifiant qu'il avait bien vu Jehanne, et rapportant des preuves de celle-ci).
En juillet 1439, à la fin du mois, la "Dame des Armoises" est à Orléans ! Elle y est bien reçue. Personne ne pense qu'elle n'est pas celle qui a chassé les Anglais de la ville, 10 ans plus tôt. On paye par l'entremise de Jacquet Leprestre :
. le 28 juillet : "14 sous parisis pour vin présenté à Jehanne des Armoises".
. le 29 juillet : idem.
. le 30 juillet : "60 sous parisis pour viande présentée à madicte Jehanne, et 21 pour 21 pintes de vin présenté à elle à disner et au soupper".
.le 1er août : "14 sous parisis pour 10 pintes et chopines à elle présentés à disner quand le mesme jour elle se party de ceste ville".
. le 1er août : "210 livres parisis pour don à elle faict le 1er jour d'aoust par délibération faicte avec le Conseil de la ville, et pour le bien qu'elle a faict à ladicte ville durant le siège, donné à elle le mesme jour que elle se party, pour ce IIc et X livres parisis".
. le 1er août : "A luy (Jacquet Leprestre) 10 sous et 8 deniers parisis pour 8 pintes de vin despensées à ung soupper où estoit JH (sans doute Jehan) LUILLIER et Thévenot de Bourges pour ce qu'on le cuidoit (le devait) présenter à ladicte Jehanne, laquelle se party plutôt que ledit vin ne fust venu".
On a beaucoup parlé sur cet article, alléguant que la Dame des Armoises, étant une usurpatrice, elle aura préféré s'en aller. Si elle a quitté la table pour s'absenter, elle est revenue quelque temps après. La suite de la rubrique établit que la Dame en question n'avait pas disparu :
"A Jehan Pichon, le 4ème jour de septembre pour six pintes et choppines, présentées à la Dame Jehanne des Armoises".
Elle avait quand même été reconnue par ceux qui l'avaient cotoyée, au temps de la délivrance de la cité, y compris par la famille Boucher qui l'avait logée, et même sa propre famille. Nombreux participants aux évènements étaient toujours vivants à Orléans, dix ans après. Toute une ville aurait-elle pu être complice d'une escroquerie ?
Monsieur Pierre de Sermoise, dans son livre (op.cit.) nous fait part d'une citation à ce sujet, en la page 250 :
"Exprimée de nos jours dans le Bulletin Syndical des Instituteurs, une opinion résume la question avec intelligence : il est quand même un peu fort que nous, qui vivons au XXème siècle, cinq cents ans après la mort de l'héroïne, ayons la prétention de dire : c'était une fausse Jeanne d'Arc, nous qui ne l'avons jamais vue, et que nous disions aux Orléanais qui l'ont vue : vous, vous étiez des imbéciles !".
"André Bourrier : l'Idée libre, 1925. Et B.S.I. octobre 1924).
Nous ne nous étendrons pas plus avant sur le problème de la "Dame des Armoises", car tel n'est pas le sujet ici. On pourra se reporter au livre de Monsieur Pierre de Sermoise pour se faire une opinion.
Au mois de juillet 1440, Isabelle "Romée" se fixe à Orléans, avec Pierre, son fils, Jehanne Baudot, l'épouse de celui-ci, et leur fils Jehan qui prendra le nom de Jehan du Lys. Sans doute aussi l'autre frère, Jehan (qui fut capitaine de Chartres) avec leur fille Marguerite (du moins quelques temps) qui, elle, restera sur place, épousant plus tard un seigneur local. On ne sait pas quand Mengin de Vouthon, frère d'Isabelle, vint résider à Luminart, sur Saint-Denis-en-Val, tout près d'Orléans.
La ville les logea dans la rue des Pastoureaux, sur la paroisse de Saint-Hilaire qui sera le lieu d'inhumation d'Isabelle en 1458.
Les Procureurs fournirent "les vivres et nécessités" et, en outre, la somme de 60 sous tournois (48 sous parisis), seulement pour Isabelle, "pour se maintenir et habiller", laquelle somme montant à deux écus et demi ou environ (l'écu valait 25 sous) lui fut payée chaque mois jusqu'à sa mort.
Voilà comment on note sa pension dans les comptes :
Par commandement des Procureurs, Jehan Lallemand, en août 1442 (par exemple) paye "à la mère Jehanne, Isabeau, mère de La Pucelle", qui résidait à Orléans, "la somme de 48 sous pour don qu'on luy faict par moys, depuis le 9 novembre 1440, pour son vivre durant le moys d'aoust".
(nb : on voit ici que le versement de cette pension est intervenu dès le 4ème mois de sa présence à Orléans).
La cité des Orléanais, par reconnaissance, s'occupe vraiment bien d'Isabelle. En mars 1441, les Procureurs payent à Geuffroy Dijon, apothicaire, 56 sous et 4 deniers "pour avoir baillé choses nécessaires de son mestier à la mère Jehanne Ysabeau, mère de La Pucelle, qui a esté fort malade".
On voit là, qu'outre la pension qu'on lui versait chaque mois, la ville d'Orléans prodiguait gratuitement des soins médicaux à Isabelle "Romée".
Elle s'éteint le 28 ou le 29 novembre 1458, probablement à Orléans où était sa résidence principale. Certains affirment que ce fut à Sandillon, à la métairie de Bagnaulx, fief de son fils Pierre où, il est vrai, elle dût séjourner souvent. Mais ce devait être à Orléans qu'elle habitait le plus souvent, sa pension étant payée dans cette ville. Quoiqu'il en soit, elle fut inhumée sur la paroisse Saint-Hilaire à Orléans, après un séjour continuel de plus de 18 ans sur les lieux des exploits de Jehanne.
Les 48 sous parisis - ou 60 sous tournois - permettaient sans doute à Isabelle d'assurer ses besoins, mais ce n'était pas une forte pension.
C'était l'équivalent de la solde d'un mois versée aux archers anglais stationnés sur le siège durant cette période.
Le mois suivant le décès d'Isabelle, au mois de décembre 1458, la ville paie, pour la dernière fois, le montant de la pension à son fils :
"A messire Pierre du Lis, chevalier, frère de feue Jehanne la Pucelle, la somme de X4 VIII (48) sous parisis, que le gouverneur a ordonné luy estre payées, pour le don que la ville d'Orliens faisoit chaque moys à feue Jehanne Ysabeau, leur mère, pour luy aidier à vivre, et pour le moys de novembre derrenièrement passé, auquel moys elle trespassa, X2 VIII (28ème jour), pour laquelle cause ladite somme a esté ordonnée estre baillée audit messire Pierre, son fils, pour faire du bien pour l'âme d'elle, et pour accomplir son testament, pour ce cas-là, X4 VIII sous parisis".
Ce testament n'a jamais été retrouvé. S'il a existé, et s'il n'a pas été détruit, peut-être gît-il dans un fond d'archives publiques ou privées.
Quelle découverte s'il venait un jour à réapparaître !
Voir la suite à l'article : Actes passés par les du Lys et descendants en Orléanais.
------ o ------
Actes passés par les du Lys et descendants en Orléanais.
Actes passés par les du Lys et descendants en Orléanais.
- Note sur les fiefs et lieux cités.
- Etude de 20 actes entre 1443 et 1539.
-- o --
Note sur les fiefs et lieux cités
Le Mont et Luminart (ou Luminard), lieux presque attenants, sur la paroisse de Saint-Denis-en-Val, se composaient de sables d'alluvion, d'une étendue assez considérable, mais de médiocre valeur, plantés d'oseraies ou à l'état de pâtures.
Luminart avait : maison, cour, courtil, vignes et 28 arpents de terres, qui étaient chargés de 28 sols 3 deniers parisis de cens annuel.
Certaines sources disent que Jehan du Lys avait récupéré Luminart dans sa succession paternelle, et l'avait loué en 1495 aux frères Chauvot, de Saint-Denis-en-Val, pour une rente de 4 livres et demie par an, avec en plus l'obligation d'y faire diverses constructions.
On peut en douter, car on étudiera plus loin deux actes de 1460, nous précisant que ce lieu appartenait à Mengin de Vouthon et à son épouse Guillemette, oncle et tante de Pierre du Lys, qui le vendent alors à un bourgeois d'Orléans nommé Jehan de Thamenay. On verra qu'il est précisé que Mengin avait obtenu ce lieu "de son conquest", et donc par un achat personnel. Il y vécurent tout de même jusqu"à leur mort.
Si le fait s'avère exact, il serait intéressant de savoir comment cet endroit est soi-disant revenu dans le patrimoine de Pierre du Lys.
Nous nous en tiendrons pour le moment aux deux actes de 1460 qui, eux, sont réels.
Le Mont était un fief des de Brunet, famille de Saint-Denis-en-Val, dont Antoine avait épousé Marguerite du Lys, fille de Jehan d'Arc (frère de Jehanne), et donc cousine et héritière de Jehan du Lys (fils de Pierre).
Le Mont fut détruit en 1789. Luminart existait encore en 1892, et un lieu, en cet endroit, porte encore ce nom de nos jours.
L'Ile-aux-Boeufs appartenait en propre à la famille d'Orléans, qui n'en concéda que l'usufruit et l'exonération fiscale.
Cette faveur accordée à Pierre du Lys et à Jehan du Lys, son fils, se transmettra à Antoine de Brunet. Cette île, constituée principalement en atterrissements de la Loire, était de contenance fort variable, par suite des délaissements ou des érosions du fleuve, lors de ses crues périodiques, qui en augmentaient ou en réduisaient l'étendue.
La métairie de Bagnault (ou Bagneaux) relevait sans doute du Chapitre cathédral. Elle ne devait pas être très juteuse, et c'est sans doute pour cette raison que Pierre du Lys sollicita - et obtint - le bail de l'Ile-aux-Boeufs, pour ainsi augmenter quelque peu son revenu.
Ces endroits étaient donc des terres agricoles, d'une assez vaste étendue, mais d'un revenu relativement faible.
La plupart de ces terres entrèrent au 16ème siècle dans les dépendances du château de l'Ile, appartenant alors au bailli Groslot. Une partie fut détruite lors de l'inondation de 1866. En 1892, le titulaire en était M, de Terrouenne.
Pour Jehan du Lys, venu par son mariage, le fief le plus important semble avoir été le lieu de Villiers-Charbonneau, en Sologne, sur la paroisse d'Ardon, et qui comportait trois ou quatre métairies et autres dépendances.
Ces domaines devaient lui permettre de vivre correctement, si l'on y ajoute les vignes et rentes diverses, avec La Couaspellière, La Goislière et aussi l'étang du Coignier.
Actes passés par les du Lys et descendants en Orléanais
- Acte n°1 (année 1443) : Vidimus d'une charte de 1443 octroyant à Pierre et Jehan du Lys, son fils, l'usufruit de l'Ile-aux-Boeufs, sur la Loire.
- Acte n°2 (année 1452) : La maison où habitèrent les du Lys, rue des Africains à Orléans, près de Saint-Pierre-le-Puellier, prise à bail du chapitre de Saint-Euverte. Reprise de cette maison par le chapitre en 1505.
- Acte n°3 (année 1456) : Mariage de Jehan du Lys avec Macée de Vézines (ou Vérines), et arrangements financiers y afférent.
- Acte n°4 (année 1460) : Vente du lieu de Luminart, à Saint-Denis-en-Val, par Mengin de Vouthon et sa femme Guillemette, à Jehan de Thamenay, bourgeois d'Orléans, et reprise le même jour du lieu par les mêmes, à titre de locataires - 2 actes.
- Acte n°5 (année 1461) : Acte d'hommage de Jehan de Cailly à Jehan de Vézines au sujet du fief de Villiers-Charbonneau à Ardon. Terre qui reviendra à Jehan du Lys par son mariage avec Macée de Vézines, fille de Jehan de Vézines.
- Acte n°6 (année 1472) : Extrait du bail de la "Maison de l'Image-Saint-Denis", qui était voisine de celle des du Lys, près de Saint-Pierre-le-Puellier à Orléans.
- Acte n°7 (année 1476) : Hommage de Jehan Damont à Jehan du Lys pour le lieu de la Couaspellière à Menestreau-en-Villette.
- Acte n°8 (année 1476) : Acte de garantie donné au sergent ducal Jehan Blémont par Jehan du Lys, au sujet de l'étang du Coignier, situé sur la Ferté-Saint-Aubin.
- Acte n°9 (année 1481) : Bail de Jehan du Lys à Guillaume Le Folletier, pour une métairie située à Villiers-Charbonneau, à Ardon.
- Acte n°10 (année 1481) : Bail de l'Ile-aux-Boeufs par Jehan du Lys aux frères Mignon, des bouchers d'Orléans.
- Acte n°11 (année 1484) : Donation d'une rente de 4 livres tournois par Jehan du Lys en faveur de Pierre Le Berruyer, bachelier en lois, étudiant à l'Université d'Orléans.
- Acte n°12 (année 1484) : Remise de dette, par Jehan du Lys, au profit de sa nièce, Jehanne Marescot, à l'occasion du mariage de celle-ci.
- Acte n°13 (année 1485) : Règlement de comptes entre Jehan du Lys et Jehan de Vézines fils, son beau-frère, au sujet de 40 livres parisis de rente qui reviennent à Jehan du Lys sur le lieu de la Goislière (à Ardon ?).
- Acte n°14 (année 1489/90) : Donation à Jehan du Lys, par Jehan d'Etampes, seigneur de La Ferté, de trois muids de blé.
- Acte n°15 (année 1493) : Renouvellement du bail concédé par Jehan du Lys à Guillaume Le Folletier à Villiers-Charbonneau.
- Acte n°16 (année 1496) : Deux dons de Jehan du Lys à Jehan des Monts : 18 livres tournois pour ses services, et un arpent de vigne à prendre sur des vignes que Jehan du Lys possède au clos de Savigny, à Sandillon.
- Acte n°17 (année 1501) : Bail de l'Ile-aux-Boeufs, par Antoine de Brunet, pour Ymbert Chevalier et à son fils Colas (Combleux).
- Acte n°18 (année 1502) : Vente faite par les ayants cause de Jehan du Lys, des biens qui proviennent de sa succession, à Antoine de Brunet, seigneur du Mont. Les ayants cause, venus de Lorraine, sont mandatés par un cousin de Jehan du Lys, Pierresson Tallevart.
- Acte n°19 (année 1525) : Problème entre Antoine de Brunet et son fils Jehan au sujet de la succession de Marguerite du Lys, qui était l'épouse d'Antoine et la mère de Jehan.
- Acte n°20 (année 1539) : Entrée en religion de Michel de Brunet, arrière-petit-fils de Jehan d'Arc/du Lys, et donc arrière-petit-neveu de Jehanne la Pucelle.
Voir les actes qui suivent :
------ o ------
Acte n°1
Acte n°1
Vidimus d'une charte de 1443, octroyant à Pierre et Jehan du Lys, son fils,
l'usufruit de l'Ile-aux-Boeufs, située sur la Loire
Suite à l'anoblissement de décembre 1429 par le roi Charles VII, Pierre d'Arc se nommait dorénavant Pierre du Lys.
Depuis juillet 1440, Pierre, Isabelle "Romée" sa mère, et d'autres membres de la famille résidaient dans l'Orléanais.
La famille vivait au début dans la rue des Pastoureaux, à Orléans. En 1442, Pierre obtiendra à bail emphytéotique, du chapitre cathédral, la métairie de Bagnault (ou Bagneaux) à Sandillon, dite aussi "la métairie des Chanoines", et qui existe toujours, bien qu'en piteux état de délabrement.
Ce n'est qu'en 1452 qu'il prendra à bail, du chapitre de Saint-Euverte, la maison située près de Saint-Pierre-le-Puellier, en ville. Les Procureurs lui accordant une rente pour vivre dans la cité, Isabelle en fera probablement sa résidence principale.
La métairie de Sandillon ne devait pas suffire à entretenir toute la famille, bien que Pierre touchera lui aussi une pension du roi, de 125 livres tournois, qui sera reportée sur son fils Jehan. Il faut dire aussi que Pierre, on l'a vu, devra vendre les héritages de sa femme pour payer sa rançon.
L'usufruit de l'Ile-aux-Boeufs, que le duc lui concède, va lui permettre de pouvoir accroître ses revenus, surtout par le forestage, ou droit de péage qu'il touchera en exploitant les bois situés sur l'île. Plus tard, son fils Jehan, puis Antoine de Brunet, son petit-cousin, vont l'exploiter de manière plus rentable.
On possède un vidimus, du 28 juillet 1443, accordant cet usufruit.
C'est un "vidimus", c'est-à-dire une ampliation du document, une sorte de "recopiage" et d'entérination effectué par les tabellions du duc, à Orléans et à Blois. En voici l'essentiel :
D'abord l'introduction, avec les formules usuelles, où l'on dit que la décision vient du duc :
"A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, le bailli de Bloiz, salut; savoir faisons que par Jehan des Estangs, tabellion juré du scel aux contraux de la chastellenie de Bloiz, ont esté tenues, veues et leues et diligemment regardées de mot à mot lres (probablement : lectres) saines et entiers en scel et escrpture scellées en cire vermeille sus double queue du grat (grand) scel de monsir. le duc d'Orliens, desquelles la teneur sensuit;"
"Charles, duc d'Orliens et de Valoys, conte de Bloiz et de Beaumot (Beaumont) et seigneur d'Ast et de Coucy."
"A noz amés féaulx gens de nos comptes général et trésorier sur le faict et gouvernement de noz finances, gouverneur, procureur et reçeveur de nostre duchié d'Orliens ou à leurs lieutenants, salut et dilection."
On expose pourquoi le duc prend cette décision en faveur de Pierre, qui l'a bien servi autrefois :
"Receue avons l'umble supplicacion de nostre bien amé Pierre du Lis, chevalier, contenant que, pour acquitter sa loyauté envers monseigneur le Roy et nous, il s'en feust départi de son païs et venu ou (au) service de mondit seigneur le Roy et de nous, en la compaignie de Jehanne la Pucelle, sa soeur, avecqs laquelle jusques à son absentement et depuis ce jour jusques à présent, il a exposé son corps et ses biens oudit service, et au faict des guerres de mondit seigneur le Roy, tant à la résistance des ennemis de ce royaume qui tindrent le siège devant nostre ville d'Orliens, come en plusieurs voïages faiz en entprins (entrepris) par mondit seigneur le Roy et ses chiefs de guerre et autrement en plusieurs et divers lieux, et par fortune desdictes guerres a esté prisonnier desdits ennemis et à ceste cause vandu les héritaiges de sa femme et perdu tous ses biens tellement que a paine a de quoy vivre ne (ni) avoir la vie de sa femme et de ses enfants".
(nb : il en avait donc plusieurs, des enfants ?)
Alors on cite et localise l'objet du don qu'on lui octroie :
"... nous requérant très humblement que pour luy aidier à ce, il nous plaise luy donner sa vie (lui procurer un moyen d'existence), la vie durant de luy et de Jehan du Lis, son fils naturel et légitime, les usufruicts, prouffiz, revenues et émolumens d'une ysle appellée l'Ysle-aux-Boeufs, à nous appartenant, assise en la rivière de Loyre, près de la Salle, au droit de Chécy, ainsi come elle se poursuit et comporte, et comprenant environ demy arpent de la dite ysle, qui est au droit de l'ostel de la Court-Dieu, appelé Guiron, laquelle ysle Jehan Bourdon et aultres tenoient naguières de nous à la somme de six livres parisis valant marc d'argent, sept livres tournoys, payant chascun an, par moictié, à deux termes, c'est à scavoir à tout et aulcun nostre seigneur, et à laquelle ysle et choses dessusdictes de nostre consentement, ils ont naguières renoncé à nostre prouffit, et pour en disposer à nostre voulenté, ainsi que plus aplain peut apparoir par lectres de renonciacion données le XXVIème jour de ce présent moys de juillet l'an mil CCCC quarente et trois".
Ce passage important renseigne que l'ancien tenancier se nommait Jehan Bourdon. C'est pour cette raison que l'île porta un temps le nom de l'Ile-aux-Bourdons.
Il semblerait que le bail ne concerne pas l'île dans sa totalité, car il est bien écrit "... demy arpent de la dicte ysle... au droit de l'ostel de la Court-Dieu, appelé Guiron". Il est possible aussi que l'on n'incluait pas le reste de l'île, fréquemment sous les eaux, au gré des crues de la Loire, et que l'on en indiquait la partie toujours émergée. L'acte se poursuit :
"Pour quoy nous, eue considéracion aux choses dessusdies, voulons en faveur et contemplacion de ladite Jehanne la Pucelle, sa soeur germaine, et des grants, hauls (hauts) et notables services qu'elle et ledit Pierre, son frère, ont faiz à mondit seigneur le Roy et nous, à la compulsion et résistance desdits ennemis et autrement, avons donné et donnons de nostre certaine science (mûrement réfléchi) et grâce espécialle, par ces présentes, audit messire Pierre, lesdits usfruiz, prouffiz, revenues et émolumens de la dite ysle et choses dessusdites pour y ceulx prandre et parcevoir doresnavant par luy et sondit filz, la vie durant d'eulx et de chascun d'eulx, tant comme le survivant d'eulx vivra et aura la vie au corps..."
Il est nettement dit qu'il s'agit d'une grâce spéciale, obtenue par Pierre et Jehan, eu égard aux services rendus à la couronne par Jehanne, leur soeur et tante, et par déférence envers elle. Arrive l'ordre du duc à son administration d'obtempérer :
"... si (aussi) vous mandons, comandons et expressément enjoignons par ces dites présentes et à chascun de vous, si come à luy appartendra et aussi à tous noz aultres justiciers, officiers et subjiés (sujets) de nostre dit duchié présents et à venir, que de nostre présent don facent, seuffrent et laissent lesdicts messire Pierre et Jehan du Lis, son filz, joir (jouir) et user plainement et paisiblement et ycelles exploictez, avoir prandre et perçevoir les prouffiz, usfruiz, revenues et appartenances, ledit temps durant, sans leur faire mectre ou donner ni souffrir estre faict, mis ou donné aulcun arrest, d'estourbier ou empeschement, au contraire".
Et aux comptables du duché de rester quites et de prendre bonne note :
"Et par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles, collationné en la chambre de noz comptes pour une foiz seulement et avecque recoingnoissance dudit chevalier joysset (jouissent) desdictes choses, nous voulons vous nostre reçeveur et tous aultres qu'il appartendra estre et demourer quictes et deschargez le temps dessusdit durant desdictes vies dudit chevalier et de sondit filz, de la recepte des revenus dessusdictes par vous, gens de noz comptes et par tous aultres à qui il appartendra sans aulcun contredit ou difficulté".
Pierre et son fils sont donc dispensé de toute fiscalité concernant cet usufruit. La suite nous apprend que d'autres bontés ont été faites au chevalier, "non exprimées dans ces présentes", et qu'aussi la famille de la Pucelle profitait de la reconnaissance ducale et royale :
"Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, non obstant quelzconques aultres dons ou biens faiz par nous audit chevalier non exprimez en ces présentes et quelzconques ordonnances par nous faictes et à faire de non donner ou aliéner aulcune chose de nostre domaine retrainçons, mandemens ou deffensement à ce contraire.
En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes.
Donné à Orliens le XXVIII jour de juillet, l'an de grâce mil cccc quarente et trois".
Le vidimus est entériné par Jehan Le Fuzelier, général conseiller de monseigneur le duc d'Orléans, et se termine ainsi :
"... Me consens en tant que en moy est, et qu'il me touche et appartient, à l'entérinement et accomplissement du contenu ès desdictes lectres, tout selon pour les causes et par la fourme et manie (manière) que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles.
Donné soubz mes saingt manuel et signet le XXIXème jour dudit moys de juillet, l'an mil cccc quarente et trois, et signée J. Le Fuzelier".
Le 2 août suivant, tout sera confirmé par le sceau de la chatellenie de Blois, et signé par Jehan des Estangs, tabellion juré du scel de cette chatellenie.
Pierre et son fils sont dorénavant et légalement usufruitiers de l'Ile-aux-Boeufs.
Deux ans et demi plus tard, en janvier 1446, sans doute sur demande des instances ducales, Pierre du Lys affirmera que tout a été bien exécuté et accompli des ordres donnés :
"L'an mil cccc quarente et six, le vendredy XXVIIème jour de janvier, messire Pierre du Lis, chevalier, confessa que, par vertu de ces présentes, les gens et officiers de monseigneur le duc d'Orléans le ont lessé et le lessent paisiblement joir et user de l'ysle et appartenences contenues au blanc et en prandre et perçevoir les fruitz et revenues pour les causes contenues en ces présentes, sans aulcune chose en paier et bailler".
(Arch. Loiret - n°A.274 - Bull. S.A.H.O., t.3, 1860)
------ o ------
Acte n°2
Acte n°2
La maison où habitèrent les du Lys, rue des Africains, à Orléans,
près de Saint-Pierre-le-Puellier, prise à bail du chapitre de Saint-Euverte.
Reprise de cette maison par le chapitre en 1505
1440 : En juillet, Isabelle "Romée" arrive à Orléans avec une partie de sa famille. La ville les loge dans la rue des Pastoureaux.
1441 : Pierre du Lys obtient à bail du chapitre cathédral la métairie de Bagnaulx à Sandillon.
1443 : Le duc d'Orléans accorde à Pierre du Lys et à son fils Jehan l'usufruit de l'Ile-aux-Boeufs située sur la Loire.
1452 : Le chapitre de Saint-Euverte accorde à bail à Pierre du Lys, une maison près de Saint-Pierre-le-Puellier à Orléans, où résidera Isabelle "Romée" et, plus tard, son petit-fils Jehan.
Avant de détailler l'acte, précisons la signification de "le Puellier".
Le mot vient du latin : puella/puellae, qui signifie : une jeune fille non mariée. Le mot "pucelle", qui en découle, signifie de nos jours une jeune fille vierge, sans doute parce que l'on considérait qu'une fille devait l'être tant qu'elle n'était pas mariée. Pour le mot "vierge", la latin a un autre mot : virgo.
En fait, on pourrait traduire puella, ou pucelle, par : demoiselle.
"Puellier" en est l'équivalent masculin, qu'on pourrait traduire par jeune homme (et non par puceau). Pour l'église en question, on pourrait dire : Saint-Pierre-le-Jeune.
Contrairement à ce que pensent beaucoup d'Orléanais, les d'Arc/du Lys n'ont pas toujours habité dans cette maison. Il étaient là depuis presque 12 ans quand Pierre obtient ce bail, le 8 mai 1452 (date symbolique), probablement pour avoir un pied à terre à Orléans.
Voulant sans doute honorer la famille de la libératrice de la cité, le chapitre de Saint-Euverte accorde à Pierre des conditions plus qu'avantageuses.
Voici ce bail :
"A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, nous, frère Adam, humble abbé de l'abbaye et église de monseigneur Sainct-Euverte d'Orliens, et tout le couvent d'icelluy lieu, salut en Nostre-Seigneur.
"Scavoir faisons que nous, pour le bien, utilité et prouffit de nous et de nostre dicte église et abbaye, pour ce aujourd'huy assemblez en nostre chapitre, par le somp (le son) de la cloiche, en la manière acoustumée, et tous d'un accord et assentement, congnoissons et confessons que nous avons baillé et baillons à rente, ferme ou pension, du jour de la Nativité Sainct-Jean-Baptiste prouchaine venant jusques à cinquante-neuf ans prouchains venans et ensuivans, à noble homme messire Pierre du Liz, chevalier, demourant à présent en la parroisse Sainct-Aignan de Sandillon, près d'Orliens, pour luy, ses hoirs (héritiers) et pour ceulx qui auront cause de luy".
C'est net : il habitait alors à Sandillon. Sans doute Isabelle devait souvent y venir, et rester quelques temps sur place, surtout les mois d'été, mais sa résidence principale devait être sur Orléans, dans la rue des Pastoureaux. Pierre voulait ainsi que sa mère ait vraiment une maison à elle, en ville, et la fit déménager pour s'installer dans celle-ci. Le bail établi pour 59 ans n'est pas une rareté. On pratiquait souvent ainsi.
"Une maison en ruyne que nous avons assise à Orliens, en la parroisse Sainct-Père-Pulier (sic) sur la rue et faisant le coing de la rue qui va de ladicte rue de Sainct-Flou à l'église dudit Sainct-Père-Publier (sic), et tenant à ... (un blanc), à tenir et exploicter ladicte maison en ruyne par ledit messire Pierre du Liz, preneur, et par ceulx qui auront cause de luy, et en faire les loyers, yssues, prouffitz et revenues siens, durant ledit temps; pour le pris et somme et trente-deux solz parisis, monnoye vallant sept livres tournois, marc d'argent, de rente, ferme ou pencion, chascun an, durant ledit temps, à nous rendre et payer chascun an, aux termes de Sainct-Jehan et de Noël;"
La maison avait beaucoup souffert, durant les combats et bombardements du siège, et on précise à deux reprises ci-dessus qu'elle était en ruines. Le loyer de 32 sols parisis, sans être excessif, laisse penser qu'elle était tout de même assez grande. Il était sans doute possible de la remettre en état sans trop de difficultés, et, pour ce faire, le chapitre accorde à Pierre les conditions suivantes :
"Sauf et excepté que ledit messire Pierre, preneur, ne (ni) ceulx qui auront cause de luy ne seront tenuz paiez aulcune chose de ladicte rente pour les deux premières années qui finiront à Noël mil quatre cens cinquante trois. Et commencera le premier terme à la Nativité Sainct-Jehan-Baptiste qui sera l'an mil quatre cens cinquante quatre.
"Auquel premier terme ledit messire Pierre du Liz ne paiera que douze solz parisis jusques à quatre ans ensuivans, qui finiront à Noël mil quatre cens cinquante et sept.
"Et de là en avant, ledit messire Pierre du Liz, preneur, ou ceulx qui auront cause de luy, seront tenuz paier par chascun an, durant ledit temps, trente-deux solz parisis de rente par an, ausdictz termes, à chascun terme seize solz parisis, le premier terme commençans à la Nativité Sainct-Jehan qui sera l'an mil quatre dens cinquante et huit".
Deux années gratuites, 12 sols durant les quatre ans qui suivront, avant de payer le loyer annuel dans sa totalité, sont des conditions plutôt avantageuses. En contrepartie, Pierre doit s'engager à retaper la maison :
"Et par ce contrault (contrat, bail) faisant, ledit messire Pierre du Liz, preneur, sera tenu mectre ladicte maison en bon estat et convenable, dedens du jourduy en six ans prouchains venans, tant de couverture comme de murailles, planchers et aultres choses; et icelle mise, la maintenir durant ledit temps; et en la ffin d'icelluy temps la laisser en bon estat et convenable, et couverte toute en thuille".
Pierre devra évidemment payer les impôts et taxes, sauf le cens qui restera à la charge du chapitre. Il payera aussi les frais éventuels de transfert de bail :
"... et paier toutes tailles d'église, de ville, puis (puits), pavés et aultres choses qui seront imposées sur ladicte maison (c'est l'équivalent de nos impôts locaux), durant ledit temps; sans riens rabatre de ladicte rente, sauf ledit cens que nous paierons en nostre main; et à chascune mutaccion qui se fera de ladicte maison, durant ledit temps, du cousté dudit preneur, soit par mort, transport ou autrement, celluy ou ceulx qui tiendront ladicte maison seront tenuz eulx venir obligez envers nous, dedens ung an après ladicte mutacion".
Et l'acte poursuit :
"Si promectons en bonne foy et soubz l'obligacion de nous, de noz successeurs et de tous noz biens et des biens de nostre dicte église et abbaye, que jamais par nous ne par aultres, encontre le bail et choses dessus dictes ne viendrons, ne assérons à venir; ainçois (ainsi ?), les ons (ont) et aurons, tendrons et garderons fermement et loyaulment, sans jamais venir contre; et ladicte maison par nous ainsi baillée à rente, ferme ou pencion, comme dict est, garentirons, délivrons et deffendrons, durant ledit temps, audict preneur, et à ceulx qui auront cause de luy, de tous empeschemens, vers tous et contre tous, en jugement et dehors, aux us et coustumes du païs".
Ces formules nous semblent un peu compliquées. Comprenons-nous absolument tout - de nos jours - de ce qui figure sur les actes de nos actuels notaires ?
Et l'acte se termine ainsi :
"Et si, rendrons et paierons tous coustemens et dommaiges qui faiz seront par deffault de garentie, de délivrance ou de deffence. Et renonçons en cest faict à tout et généralement que dire et proposer pourrions contre ces lectres ou la teneur d'icelles;"
"En tesmoing de laquelle chose nous avons seelé (scellé) ces présentes de noz séaulx; qui furent faictes et données en nostre dit Chappitre le lundy huityesme jour de may, l'an mil quatre cens cinquante et deux".
La famille fut longtemps locataire de cette maison, de 1452 et probablement jusqu'au décès de Jehan du Lys en 1501, soit 49 années.
C'était donc véritablement "la maison des du Lys".
Quand Jehan décède, le bail n'était pas terminé, les 59 ans prévus n'arrivant à terme qu'en 1511.
Marguerite du Lys, cousine et héritière de Jehan, et son mari, Antoine de Brunet, ne semblent pas avoir repris cette maison. Peut-être ne les intéressait-elle pas.
La maison sera reprise par le Chapitre en 1505 par le chapitre de Saint-Euverte, dans la manière et les conditions qu'on va découvrir ci-après.
Reprise de la maison par le chapitre
En 1505 on reparle de cette maison. La prévôté d'Orléans la fait saisir, pour être cédée aux enchères au plus offrant.
Quelle en est la raison ? Elle devait être vide et abandonnée, mais restait quand même toujours la propriété du chapitre. Le prévôt fait établir l'acte suivant :
"A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Loys Roillart, licencié en loiz, conseiller du Roy nostre sire, garde de la prévôté, salut.
"Comme à la requeste du procureur du Roy nostre sire ou bailliage d'Orliens, Jehan Lignage, sergent et crieur des bans, criz et proclamacions du Roy nostre sire ès ville et prévosté d'Orliens, eust dès le huityème jour de novembre, l'an mil cinq cens et cinq, pris, saisy et mis en la main du Roy nostre sire, le droit de tenue et seigneurie utille, durant le temps que, une maison assise à Orliens, sur la rue par où l'en va de la Tourneufe à l'église Sainct-Flou, faisant le coing des rues à aller de Sainct-Père-Pullier à Sainct-Aignan, est à tenir; tenant d'une part icelle maison à ladicte rue où l'en va de ladicte rue à l'église Sainct-Flou, d'autre part aux hoirs feu Androuet, et d'autre part aux hoirs feu Jaquet Habert; laquelle maison fust et appartint à feu Jehan du Lis et est de présent vacant par faulte de détenteurs et de héritiers dudit du Liz; pour icelle maison estre criée, vendue et décrétée, aux charges anciennes et foncières, et au plus offrant et dernier enchéresseur".
La maison est bide d'occupant, et on va le signeler et le "crier" au lieu habituel, le Châtelet, afin de trouver quelqu'un d'intéressé.
Le sergent Jehan Lignage est chargé de cette tâche. Quelqu'un portant le même nom et le même prénom est cité, dans les comptes de la ville, le 6 mai 1429 : Jehanne et les français ont passé la Loire et stationnent devant les Tourelles du pont, face aux Anglais; les Orléanais ravitaillent les roupes; Jehan Lignage, boulanger de la cité, va fournir "8 douzaine de gros pains chauds", pour nourrir les combattants qui prendront les Tourelles le lendemain. Celui-ci était-il le père de l'autre ?
Le sergent de la prévôté met en route la procédure :
"Et ledit jour se feust ledit Lignage, sergent, transporté devant le prétoire de (du) Chastellet d'Orliens, qui est le lieu acoustumé à faire criz et publicacions.
"Auquel lieu, heure et manière en tel cas acoustumé, pour premier cry et première quinzaine, eust crié et faict cryer et publier à haulte voix que il avoit mis et exposé, mectoit et exposoit ladicte maison dessus déclairée en vente, criées et subhastacions (?), à la requeste dudit procureur, aux charges des cens et droiz seigneuriaulx que peut devoit ladicte maison, pour les deniers qui ystront (découleront) de la vente, tourner, convertir et employer au prouffit du Roy nostre dict seigneur, et ailleurs où raison sera".
S'il y a un acquéreur, il faudra qu'il se présente dans les délais prescrits; la même chose s'il s'avérait que quelqu'un revendiquerait des droits sur cette maison :
"en faisant assavoir à tous en général que s'il y avoit personne qui ladite maison dessus déclairée voulsist (eut voulu) achapter et mectre à pris, ou sur icelle ou à la distribucion des deniers qui en ystroient aucune chose demander veusist avant, pendant le procès et délay desdictes criées; et il seroit sur tout oy (entendu) et receu, et luy seroit faicte raison et justice.
"Et sinon, lesdictes criées faictes et parfaictes et le décret sur ce donné, jamais aulcun n'y viendroit à temps, mais en seroit du tout fourcloux (forclos) et débouté".
Ce qui veut dire que, si des ayants droits existent, ils doivent se faire connaître rapidement sinon la maison reviendra au roi. Puis vient la relation des autres "criées" légales :
"Et en continuant lesdictes criées, eust ledit Lignage, sergent et crieur dessus dict, le samedy vingt-deuxyesme jour dudit moys de novembre, mis et exposé ladicte maison en ventes, criées et subhastacions pour second cri et seconde quinzaine;
"Item, pour tiers et tierce quinzaine, le samedy sixyesme jour de novembre. (sic, mais erreur : il s'agit de décembre bien sûr).
"Et pour mectre fin et parachever lesdictes criées, eust icelluy sergent, le samedy vingtiesme jour dudit moys de décembre, ou dit an, exposé et mis ladicte maison en vente, criées et sushastacion pour une huitine (huitaine) d'abondant et dernier cry, auquel cry et aultres précedans il eust faict semblables proclamacions que faict avoir ou dit premier cry;"
Le sergent a donc, à chaque fois de la même manière, crié cette affaire aux dates indiquées.
Mais, deux oppositions se soulèvent. Il aura fallu du temps ! Pourquoi la réaction a-t-elle été si tardive ? Quoiqu'il en soit, donc, deux opposants : les religieux du chapitre Saint-Euverte, et un nommé Pierre Le Berruyer.
Ce dernier avait été bénéficiaire, en 1484, d'un don de Jehan du Lys, en l'occurence d'une rente de 4 livres tournois, pour l'aider à terminer ses études de droit à l'Université d'Orléans (voir ci-inclus, acte n°11). Pourquoi fait-il opposition à la vente de cette maison, ou audroit d'usage de celle-ci ? Peut-être avait-il l'intention de la reprendre, en souvenir de son bienfaiteur et de la générosité que celui-ci lui avait manifesté ? On ne sait.
(Petite parenthèse : Le Berruyer semble indiquer que ce Pierre était d'origine berrichonne. Berruyer = berrichon).
Les opposants sont donc convoqués au Châtelet, le 23 février suivant, pour y exposer chacun leurs raisons :
"à l'encontre desquelles criées se feussent opposez les religieux, abbé et couvent de l'église monseigneur Sainct-Euverte d'Orliens, et honorable et saige maistre Pierre Le Berruyer.
"A quoy, par ledit sergent, eussent esté receuz et jour à eulx préfix (rendez-vous fixé) et assigné pour dire les causes de leur opposicion, et au dit procureur du Roy, pour soustenir lesdictes criées, à comparoir pardevant Nous, ou nostre lieutenant en Chastellet d'Orliens, au vingt-trois (ème) jour de février prouchain et ensuivant, et pour proceder èsdictes criées, et en oultre ainsi qu'il appartendra par raison, ainsi que ces choses sont à plain contenues et déclairées en la relacion et procès-verbal dudit Lignage, sergent, duquel la teneur s'ensuit".
Vient alors le procès-verbal du sergent, reprenant tout ce qui est dit ci-dessus, et qui se termine ainsi :
"... Et tout ce, mon très-honoré seigneur, vous certiffie estre vray par ceste ma relacion scellée et signée de mes seel et seing manuel.
"Ce fust faict l'an et jour dessus dits.
"Ainsi signé : J. Lignage".
Vient l'opposition du couvent de Saint-Euverte, qui fait valoir que la maison avait jadis été prise à bail par Pierre du Lis :
"Auquel jour ou aultre d'icelluy deppendant, ledit procès de criées eust esté rapporté par devers nous.
"Et ce faict, eussions assigné jour ausditz religieux et Le Berruyer à fournir de leurs causes d'opposicion, lectres et tiltres, à certain aultre jour; auquel iceulx religieux, abbé et couvent de Sainct-Euverte eussent fourni de leurs causes d'opposicion, lectres et tiltres, requérans estre préférez et mis en ordre pour la somme de trente-deux solz parisis de rente ferme ou pencion chascun an, paiables aux termes de Sainct-Jehan et Noël.
"Laquelle rente noble homme messire Pierre du Liz, chevalier, dès le huityesme jour de may, l'an mil quatre cens cinquante et deux, pris à tiltre de rente, ferme ou pencion, desdicts religieux, abbé et couvent de Sainct-Euverte, qui luy baillèrent soubz leurs seaulx ladicte maison dessus déclairée, du jour de la Nativité Sainct-Jehan-Baptiste lors prouchaine venans jusques à cinquante-neuf ans prouchains ensuivans; comme tout ce peut apparoir par les lectres dudit bail sur ce faictes et passées lesditz an et jour, et desquelles la teneur s'ensuit".
Les religieux font donc valoir que cette maison leur appartient et leur procure des rentes. Ils le prouvent en exhibant le bait fait à l'époque à Pierre du Lis, dont une copie vient alors s'intercaler dans l'acte.
Pierre Le Berruyer ne devait pas avoir d'opposition valable et, en tous cas, pas de document à présenter pour se justifier. Il va se désister.
"Et au regard dudit, maistre Pierre Le Berruyer eust déclairé qu'il se désistoit de ses causes d'opposicion, voullant et consentant que ladicte maison fust vendue et décrétée nonobstant icelle opposicion, come par nos lectres d'appoinctement sur ce par nous données, desquelles la teneur s'ensuit, peut à plain apparoir".
La cause est entendue. On résume l'affaire, prenant note que le chapitre de Saint-Euverte sera représenté par un dénommé Fleurantin Mairart (c'est le représentant du chapitre ?), et on met à statuer pour un décret dont la promulgation interviendra dans quelques jours.
"Saichent tous que en la cause meue et pendant par devers nous, prévost d'Orliens, entre la procureur du Roy, demandeur en procès, d'une maison qui fust à feu Jehan du Liz, comparant en sa personne, contre les religieux, abbé et couvent de Sainct-Euverte d'Orliens, comparant par Fleurantin Mairart, leur procureur, et Me. Pierre Le Berruyer, en sa personne, deffendeurs et opposans.
"A esté tant proceddé, que après que ledit Berruyer s'est désisté de ses causes d'opposicion, voulant et consentant que ladicte maison soit vendue et décrétée (faisant l'objet d'un décret, d'un arrêté), nonobstant ladicte opposicion; avons assigné et assignons jour ausdictes parties, à décréter à jeudy prouchain.
"Donné soubz le seel aux causes de ladicte prévosté, le trente et pénultième (le 31) jour de mars avant Pasques, l'an mil cinq cens cinq;
"Ainsi signé : D. Barbedor".
Ca Barbedor était sans doute le tabellion qui rédigeait les actes. Le nom est amusant ! Sans doute était-il blond ?
Précisons ici que, l'année débutant alors à Pâques, le "31ème jour de mars avant Pasques" " était en fait le 31 mars 1506.
Quelques jours plus tard, le 2 avril 1505 avant Pâques (donc 1506), le décret est signé et promulgué. Le texte reprend tout le déroulement ci-dessus, et accorde audit Mairart le droit de tenure de la maison. Il aura ainsi le droit de l'habiter, et de la prendre à bail du chapitre, comme personne d'autre n'en revendique le droit. Il était donc le procureur du chapitre, mais aussi le nouveau tenancier de la maison.
"Ausquieulz pris et charges ledit droit de tenue de la maison dessus dicte est demouré audit Mairart, oudit nom, comme au plus offrant et dernier enchéresseur; combien que nous avons enquis et demandé à plusieurs assistans par devant nous, s'il y avoit personne que ledit droit de tenus vousist achapter et acquitter les pris et charges dessus dictes; et sur ce faict longue stacion et demouré. A quoy ne s'est apparu personne.
"Et partant, avons audit Fleurantin Mairart, oudit nom de procureur, vendu, livré et adjugé, vendons et adjugeons par nostre sentence, auctorité et décret, ledit droit de tenue dessus déclairé, aux pris et charges dessus dictes, comme au plus offrant et dernier enchéresseur; en luy en baillant la possession, saisine, seigneurie, fons, tresfons et aultres poursuictes qui en deppendent, par le signe et tradicion d'une plume qu'il a prise et acceptée pour lesditz religieux, abbé et couvent de Sainct-Euverte, leurs successeurs et aians cause ou temps avenir".
Que veut dire : "par le signe et tradition d'une plume qu'il a prise et acceptée" ? La coutume voulait-elle alors que, lorsqu'on était d'accord pour une transaction, on reçevait une plume et que, dès lors, la transaction était complète et terminée ? Il serait sans doute intéressant de rechercher si cette mention figure dans d'autres décrets de ce type. Etait-ce une coutume purement Orléanaise ou ducale, ou bien cela se pratiquait-il ailleurs ?
Quoiqu'il en soit, la formule est élégante.
"Si donnons en mandement au premier sergent royal en ladicte prévosté et ressorz sur ce requis, que lesdictz religieulx, abbé et couvent de Sainct-Euverte, ou ledit Mairart leur procureur il mecte en possession et saisine dudit droit de tenue de ladicte maison dessus dicte, à présent vandue.
.....
"Donné soubz le scel aux causes de ladite prévosté, le second jour d'avril avant Pasques, l'an mil cinq cens et cinq". (donc 1506).
"D. Barbedor".
Là on a précisé que la maison est vendue. Mairart en est donc le nouveau propriétaire.
nb : on retrouvera Pierre Le Berruyer en étudiant l'acte n°11.
(Archives du Loiret, série H, fonds de Saint-Euverte; liasses des paroisses. Une pièce formée de trois feuilles de parchemin cousues ensemble. Ancienne cote 225).
------ o ------
Acte n°3
Acte n°3
Mariage de Jehan du Lys avec Macée de Vézines et
arrangements financiers y afférent
Jehan du Lys, fils de Pierre d'Arc/du Lys, allait épouser Macée de Vézines, d'une famille d'origine berrichonne.
Le père de Macée, Jehan de Vézines, écuyer, avait en fief le lieu de Villiers-Charbonneau, situé sur la paroisse d'Ardon, et qui reviendra plus tard, par Macée, à Jehan du Lys.
Un contrat de mariage est établi le 26 mars 1456 à Orléans.
Le mariage fut célébré le 19 juillet, en l'église de Saint-Pierre-le-Puellier, à Orléans. Ce fut le dernier évènement familial où se trouva Isabelle "Romée".
A cette occasion, la ville d'Orléans offrit aux jeunes époux la somme de 16 livres parisis, dans une bourse en velours qui coûta 2 sols et 4 deniers.
Le repas avait eu lieu la veille, lundi 18 juillet, sans doute dans la maison où résidait Isabelle "Romée", à deux pas de l'église en question.
La cité avait acheté chez Simon Le Mazier, hôtelier de l'Auberge de l'Ange, 51 pintes de vin, "tant blanc que vermeil présenté par la ville au disner et soupper des nopces du filz (de) messire Pierre du Liz, chevalier, frère de feu Jehanne la Pucelle, pour ce qu'il estoit venu faire sa feste du village (de Sandillon) en ceste ville, et n'avoit point de bon vin vieil de provision pour pouvoir festoyer". (comptes de la ville).
Venons-en au contrat de mariage :
"Le samedy XXVIème jour de mars avant Pasques, Jehan du Lis, escuier, filz de messire Pierre du Liz, chevalier, et de dame Jehanne (Baudot) sa femme, en la présence et de l'auctorité de ses ditz père et mère, d'une part, et Jehan de Vézines, escuier, et damoiselle Jehanne Gouygnete (ou Gouynette), sa femme, d'autre part; lesdictes femmes auctorisées... Confesse que au traictié de mariaige et par le mariaige faisant dudit Jehan du Liz, à la personne de damoiselle Macée, fille desdicts Jehan de Vézines et de damoiselle Jehanne, sa femme, ilz ont faict entre eulx les dons, dote, promesses, convenances et choses cy après déclairées.
"C'est assavoir que ledit Jehan du Liz a promis de prandre ladicte damoiselle Macée, par nom de mariaige, et ledict Jehan de Vézines et sa femme la luy ont promise donner et bailler à femme et espose se (si) Dieu et saincte église si accordent."
Une promesse de mariage était alors une chose très importante, et la rompre constituait alors un acte très grave.
Jehanne La Pucelle elle-même fut assignée à l'Official de Toul, tribunal ecclésiastique, pour avoir rompu la promesse de mariage que Jacques d'Arc avait faite pour elle à un jeune homme de la région. Elle s'en tira en affirmant "qu'elle ne lui avait rien promis".
Poursuivons la lecture de l'acte; Jehan de Vézines promet d'accorder une rente aux jeunes futurs époux :
"Et avec ce ont lesdits Jehan de Vézines et sa femme promis paier et bailler ausdits Jehan du Liz et damoiselle Macée, à cause d'elle, chascun an, durant les vies desdits de Vézines et sa femme, la somme de dix livres parisis de rente, aux termes de Sainct-Jehan-Baptiste et Noël, par moictié, le premier terme commançans à Noël prouchain venant".
A cette époque coexistaient la livre tournois, de Tours, et la livre parisis, de Paris, cette dernière étant un peu plus forte.
On édicte que les époux pourront, soit accepter la rente de 10 livres parisis de rente, soit opter pour une somme de 150 écus d'or (beau pactole !), payée en une seule fois mais, en ce dernier choix, renoncer alors à tout ce qui pourrait échoir à Macée sur l'héritage de ses parents, choix à faire après leurs décès :
"Et a esté dit et accordé que, après le trespas desdits de Vézines et se femme, lesdits Jehan du Liz et damoiselle Macée prandront à touziousmés (à perpétuité) ladicte somme de 10 livres parisis de rente sur les héritaiges et biens desdits de Vézines et sa femme, ou pour et en lieu d'icelle rente, la somme de cent et cinquante escuz d'or pour une fois paiés (réglés en une seule fois), pour et en lieu de toute et telle partie et porcion de biens meubles et héritaiges que à icelle damoiselle Macée pourra eschoir et advenir par les successions de sesdits père et mère; pourveu toutesvoye que se (si) icelle Macée veult venir ausdictes successions de ses dits père et mère, faire le pourra par ainsi que elle ne aura pas ladicte somme de 10 livres parisis de rente, ne ladicte somme de CL (150) escuz d'or".
Donc, soit la rente, soit les 150 écus d'or, mais pas de droit à l'héritage, ou droit à l'héritage, mais plus de rente et pas d'écus. Qu'ont-ils choisi ?
A présent, les sommes et conditions concernant les du Lys et les clauses en cas de décès :
"Et pour ledict mariaige estre consommé et acompli, ledit Jehan du Liz a doéé (doté) et doe (dote) ladicte damoiselle Macée de la somme de cent escuz d'or de doe à prandre pour une fois sur la part des biens qui, par la succession dudit Jehan, avendront (adviendront) à ses héritiers.
"Ou cas toutes voyes que ledit Jehan yra de vie à trespasssement avant elle sans enfans d'eulx, et se enfans y a, elle ne prandra pour sa dicte dote que cinquante escuz d'or à prandre comme dessus; lequel dote se prandra tel comme dessus est dictou cas que ledit Jehan yroit de vie à trespassement avant ses dicts père et mère.
"Et se ledit messire Pierre et sa femme vont de vie à trespassement avant ledit Jehan leur filz, ladicte damoiselle Macé sera doée de dote coustumée ou de ladicte somme de cent escuz d'or ou choix d'elle".
Que veut dire "de dote coustumée" ? Sans doute y avait-il une règle.
Et une dernière clause pour les enfants qui pourront toucher la part de leur mère Macée, si celle-ci décède avant ses parents. (Cette clause ne jouera pas, Jehan et Macée n'ayant pas eu de descendants).
"Et a esté dit par ledit mariaige faisant que au cas que ladicte damoiselle Macée yroit de vie à trespassement avant ses dits père et mère, et même ou l'un d'eulx, délaissant enffans de leur dit mariaige, que lesdits enffans vendront (viendront) ce bon leur semble, aux successions desdits de Vézines et sa femme, avect leurs aultres enffans (c'est-à-dire avec les frères et soeurs de Macée), pareillement que feroit ladicte damoiselle Macée se elle estoit vivant, et y présenteront sa personne".
"Paié par messire Pierre XVI deniers, et par ledit Vézines 11 solz.
Un contrat bien tourné, en bonne et due forme, où tout est prévu.
(Minutier de Me. Paillat, Notaire).
------ o ------
Acte n°4
Acte n°4
Vente du lieu de Luminart, à Saint-Denis-en-Val, par Mengin de Vouthon et
sa femme Guillemette, à Jehan de Thamenay, bourgeois d'Orléans, et
reprise du lieu le même jour, à titre de locataire, par Mengin.
Deux actes
Lieu situé sur la paroisse de Saint-Denis-en-Val, Luminart fut occupé longtemps par Mengin de Vouthon (frère d'Isabelle "Romée") et son épouse Guillemette. Ils n'eurent pas d'enfant.
Luminart était attenant au domaine du Mont, les deux sites étant repris plus tard par les seigneurs de l'Ile, lieu situé tout près de là. Il semble certain que cette propriété ait appartenu en propre à Mengin de Vouthon, grand-oncle de Jehan du Lys comme frère de sa grand-mère Isabelle.
Le 6 septembre 1460, Mengin vend Luminart, pour 10 livres tournois (somme assez modeste) à un Orléanais nommé Jehan de Thamenay.
Vu la relative modicité de la somme, il est probable que la propriété en question n'était pas importante. Sans doute l'acheteur voulait-il faire un investissement pour l'avenir. L'acte de vente est assez complet :
"Mengin de Voton (sic), natif de Voton en Lorraine, oncle de feu Jehanne la Pucelle, de présent demourant en la parroisse Sainct-Denys-en-Vaulx, lequel tant pour luy en son nom, comme pour et au nom de Guillemette, sa femme, et promectant la faire consentir et obliger si toust que requis en sera... et par ces présentes vend, cedde, transporte et du tout délaisse, dès maintenant pour tousioursmès, à Jehan de Thamenay, demourant à Orliens, en la parroisse Sainct-Donnacian (Saint-Donatien), ad ce présent et acceptant, les héritaiges qui s'ensuivent".
La propriété était aux deux noms de Mengin et de Guillemette, mais celle-ci semble ne pas être présente au moment de la vente. L'acte se poursuit, donnant la description des lieux :
"C'est assavoir ung petit lieu ou a logeis (où il y a un logis), petite grange, vergier, bois, aisances et appartenances audit lieu... ou de présent demourent lesdiz Mengin et sadicte femme, assis au lieu de Luminart, en la parroisse Sainct-Denys-en-Vaulx, tenant d'une part au chemin allant dudit lieu de Luminart à Jarguau, d'autre part à une noé nommée la noé à Lalemande, d'autre part à la turcie de la rivière de Loyre; icellui lieu contenant environ arpent et demi d'éritaige".
Après l'endroit où s'élève la maison, on décrit les dépendances. On y apprend les noms des voisins :
"Item, une pièce de bois contenant environ trois quartiers, qui fust à feu Guillot Fermain, tenant à ladicte noé à Lalemande, d'une part, ung foussé (fossé) entre deux, d'autre part au long du champ de Sainct-Euvertre, par un bout au talu de ladicte rivière".
Et encore quelques terres; situées un peu plus loin, non attenant au reste :
"Item, ung arpent de terre, ou environ, assis au lieu des Plantes, tenant à Jaquet Pastault, d'une part, et à Pierre Charpentier de deux aultres parts".
Dans la suite, il est bien précisé que Mengin avait acquit la propriété "de son conquest", c'est-à-dire de ses propres deniers, à un cordonnier :
"Iceulx héritaiges mouvans du conquest dudit vendeur, par luy faict de Denys Janvier, cordoannier, comme il disoit; chargez iceulx héritaiges des cens et charges foncières qu'ilz pèvent devoir...".
Pour l'anecdote, le mot "cordonnier" vient de la ville de Cordoue, en Espagne, de laquelle on importait un cuir réputé pour sa qualité. Les gens qui travaillaient ce cuir étaient dits alors "cordouaniers", ce qui a donné, par mutation ou déformation dans le temps, des patronymes tels que : Corvisier, Courvoisier, Corvizart, et autres.
On indique alors le prix de la vente :
"Ceste vente faicte pour la somme de dix livres tournoys, monnoye courant à présent, que icellui vendeur a confessé en avoir pour ce eue et receue dudit achapteur et dont icellui vendeur s'est tenu contant et bien païé, et en quicte ledit achapteur...".
La vente est donc faite.
Bizarrement, par un acte daté du même jour, Mengin de Vouthon reprend à titre de locataire le petit domaine qu'il vient de vendre à Jehan de Thamenay.
Quelle en est la raison ? Il est possible que Mengin et son épouse, obérés et ne pouvant plus entretenir la maison, aient préféré la transférer à cet Orléanais qui, peut-être par déférence à ce couple âgé, leur fera un loyer annuel très raisonnable, et peut-être aussi par souvenir de leur nièce, Jehanne la Pucelle. C'est un bail à vie, jusqu'au trépas de Mengin et Guillemette :
"Ledit Mengin de Voton confesse avoir pris à tiltre de loage (louage, location), ferme ou pencion, dudit Jehan de Thamenay, qui a confessé luy avoir baillé audit tiltre de ferme ou pencion, lesdits héritaiges dessus déclairez, du jourd'huy, jusques durant le plain cours des vies desdiz de Voton et sadicte femme, et jusqu'au trépas du survivant et derrenier de vie d'eulx deux...".
On précise le loyer et le terme :
"... pour la somme de six solz parisis par an, icelles vies durans, païables par chascun an par icellui Mengin audit Jehan de Thamenay et au terme de la feste de Toussains; le premier paiement commançans de la feste de Toussains prouchaine venans, en ung an".
Le couple devra veiller à maintenir les lieux en bon état, le nouveau propriétaire, lui, s'engageant à faire refaire les toitures :
"Et par ce bail faisant, seront tenuz iceulx mariez de mectre, tenir, sous-tenir et maintenir iceulx héritaiges, tant de couverture, cheminée, charpenterie, comme autrement en bon estat et convenable, moyennant que icellui Thamenay a promis de faire couvrir lesdictes maison et grange, dedens Karesme prenant prouchainement venant. Et à la fin dudit temps, les lesser en bon et souffisant estat".
Et enfin, bien sûr, les charges et impôts restent à payer par Mengin :
"Et aussy paieront du leur iceulx preneurs, pour et au nom dudit achapteur, les cens et charges foncières avec toutes tailles de guerre, de puis (puits), de turcie, de rivière et aultres charges et subvencions qui seront mises et imposées sur iceulx héritaiges le temps desdictes vies durant. Promectans et obligeans par foy de chascune partie, consentans....".
Mengin et Guillemette eurent ainsi une rentrée d'argent qui dut bien leur convenir, car ils ne semblent pas avoir été bien riches. La maison et la grange reçurent de nouveaux toits, et le couple resta ainsi là où il avait vécu.
Dans ce contrat de location, tout se passe comme si Jehan de Thamenay, qui était peut-être un proche ou un ami du couple, avait voulu qu'ils restent tous deux sur place.
Le couple n'ayant pas eu d'héritiers, il a dû récupérer les lieux après leurs morts.
Plus tard, Luminart sera incorporé au domaine de l'Ile tenu par la famille Groslot.
(Minutes de Jehan Petit, notaire au Châtelet d'Orléans en 1460. Etude de Me. Regnault, notaire à Orléans, successeur de Jehan Petit et dépositaire de ses minutes).
------ o ------
Acte n°5
Acte n°5
Acte d'hommage de Jehan Cailly à Jehan de Vézines
au sujet de Villiers-Charbonneau à Ardon.
Terre qui reviendra à Jehan du Lys par son mariage avec
Macée de Vézines, fille de Jehan de Vézines
Cet acte ne concerne pas directement les du Lys, mais il donne une bonne idée de ce que devait être le fief de Villiers-Charbonneau. L'hommage était un acte de soumission et de respect que le vassal devait à son suzerain.
Jehan Cailly, notaire d'Orléans, fut un moment redevable à Jehan de Vézines pour une métairie située sur ce site, dans la paroisse d'Ardon, au sud d'Orléans.
Jehan de Vézines était donc toujours en vie en 1461, et Jehan du Lys, déjà marié à sa fille Macée, n'était pas encore le seigneur en titre du lieu.
"Le XXVème jour d'aoust (1461)... noble homme Jehan de Vérines (sic, pour Vézines), escuier, demourant en la parroisse de Mensay ou (au) diocèse de Bourges; lequel recongnut et confessa avoir mis et receu, et de faict mist et receut, présent ledit notaire, en ses foy et hommaige, sauf son droit et l'autruy, Jehan Cailly, notaire dudit Chastellet d'Orliens, à ce présent, de certains champart, coustume et aultres et aultres droitz seignoriaulx que ledit Jehan Cailly, à cause de Marion Ladmiraulde, sa femme, a en la parroisse d'Ardon, tenu en fié (fief) dudit escuier, à cause du lieu de Villiers-Charbonneau à luy appartenant, séant en la parroisse d'Ardon".
Dans ce qui est dit ci-dessus, on apprend que les de Vézines étaient originaires de la région de Bourges, et que Jehan Cailly tenait ses droits sur la métairie de par son mariage avec Marion. S'ensuit la localisation, la contenance et description du fief, et les tenanciers :
"Desquiels champars, coustume et droits seignoriaulx la déclaration s'ensuit :
"C'est assavoir : d'un champart assis au lieu nommé Esser, en la parroisse d'Ardon, qui se extend sur plusieurs héritaiges assis en ladite parroisse, reddevables dudit champart. Et premièrement :
- la mestaierie Guillaume Mignon; la mestaierie Richard d'Esser et ses enffans; la mestairie qui fust à feu Richard d'Esser (père, sans doute). Et sont bornées icelles mestaieries par la borne qui vient de la Croix de Villiers, en venant jusques à la borne dont est bornée la terre des Gallines, et en venant d'icelle borne droit à la noue Guillaume Mignon, et de ladicte noue jusqu'aux Bois-Thierry.
- Item, les terres assises devant Esser, qui sont Hervé d'Esser et André Le Musnier, et sont bornées de la borne Pierre Loireau, jusques à Esser, et toutes les terres qui sont entre les vignes d'Esser et le Bois-Thierry.
- Item, neuf mines de terre qui sont à Gabriel Boileaue, assises à Morteinch, mouvans du lieu de la Tonnelière.
- Item, quinze minées de terre assises à Morteinch, mouvans de la métaierie dudit Boniface.
- Item, six mines de terre assises derrière la mestaierie dudit Cailly, qui sont feu Boniface Ladmirauld.
- Item, huit mines de blé, quatre pains, quatre deniers et quatre gélines deues par chascun an audit Cailly, le dymenche d'après l'an neuf, ledit blé à la mesure de La Ferté-Nabert (aujourd'hui La Ferté-Saint-Aubin)".
On s'aperçoit que le fief, bien et clairement délimité, est important, constitué de plusieurs métairies, tenues par plusieurs familles de tenanciers.
Les profits venaient du blé, sans doute d'autres cultures, de petit élevage et aussi du vin; la forêt devait aussi générer des profits avec le vente du bois.
La mine, mesure de quantité pour les matières sèches, représentait 78 litres. Les huit mines de blé étaient-elles une bonne récolte par rapport à la surface ?
L'acte précise les redevances dévolues à chacun d'eux :
"Lesquelles choses dont deues de rente sur quatre hostelz et sur les appartenances d'iceulx, séans en la parroisse d'Ardon. C'est assavoir :
. la métaierie Hervé d'Esser, deux mines de blé, ung pain, une géline et ung denier;
. sur la métaierie feu Hervé d'Esser, autant;
. et sur la métaireie dudit Cailly, qui fust audit feu Boniface, autant,
et à cinq sols parisis de deffault pour ladite rente non paier audit jour, sur chascun desdiz hostelz.
"Item, aultres neuf deniers parisis de coustume deue, chascun an, audit Cailly, sur sadicte métaierie.
"Item, aultres neufs deniers parisis de coustume, chascun an, audit Boniface, sur la mestaierie des hoirs feu Hervet d'Esser".
Enfin, Jehan de Vézines donne quittance, et exprime sa satisfaction :
"Et avec, a confessé ledit escuier avoir esté paié, satisfait et contenté dudit Cailly, du rachat de prouffit du fié à luy deu, à cause desdiz champars. Et acquicté... Promectant...".
Une partie des redevances n'était pas toujours due en argent, mais aussi "en nature", tel qu'une géline ou un pain.
(Minutes de Chauvreux, notaire. Etude de Me. Francheterre, à Orléans).
Jehan Cailly, notaire au Châtelet d'Orléans, a laissé de nombreux actes. On le cite aussi dans les comptes de la ville, lors de l'arrivée de Jehanne La Pucelle sur Orléans, accompagnée d'hommes d'armes, mais aussi d'un convoi de munitions et de vivres, en particulier de blé, qui transite par chaland de Chécy à Orléans. C'est lui qui mesura le blé lors de la mise en grenier :
"A Jehan Cailly, nottaire, pour plusieurs journées d'avoir vacqué à mesurer le blé : 6 livres parisis".
"A Guiot Boilleve, pour despence faicte en son ostel quand on mesura le blé, par Jehan Morchoasme, Jehan Martin, Cailly et aultres : 4 sous parisis.
Le Guiot Boillève est-il le Guiot "Boileaue" qui se distingua au siège de 1429 ?
On le retrouve, le même jour, lors de l'arrivée du blé du 29 avril, rémuniré pour la location de son grenier pour y entreposer une partie de la cargaison :
"A Guiot Boillève, pour le louaige de son grenier où a esté mis la plus grant partie du blé de la ville et mesuré : 4 livres parisis."
Un autre nom, sur cet acte, attire notre attention : Guillaume Mignon, qui tenait l'une des métairies de Villiers-Charbonneau.
Est-il en famille avec les trois frères Mignon, Estienne, Jacques et Berthier, bouchers d'Orléans, à qui Jehan du Lys, 20 ans plus tard, fera un bail pour les pâturages de l'Ile-aux-Boeufs ? (voir Acte n°10).
En ce qui concerne Marion "Ladmiraulde", on la nommait ainsi parce qu'elle était la femme d'un certain "Ladmirauld". Un Guillaume Ladmirauld se distingua au siège en 1429.
Voir les autres actes à la rubrique : Famille de Jehanne la Pucelle - B.
------ o ------